Concevoir une émission de médiation scientifique à l’échelle d’une université : logiques d’acteurs et enjeux de médiation
Résumé
La Grande Enquête !, émission télévisée au cœur du Projet MérLin – portée par l’Université de Lille dans le cadre du label SAPS – illustre l’implication croissante des universités dans la médiation scientifique. En tant que membres du comité de rédaction de l’émission, notre équipe de chercheur·e·s en Sciences de l’Information et de la Communication a participé à la conception et à la réalisation de cette émission télévisée scientifique, et observer la complexité des dynamiques éditoriales issues du partenariat entre université, chaîne de télévision et association de médiation scientifique. Grâce à une méthodologie mixte combinant entretiens semi-directifs avec les acteur·ice·s du projet, observation participante et analyse des émissions, l’article examine la construction éditoriale et la médiation des savoirs scientifiques dans une émission télévisée co-réalisée en contexte universitaire.
Mots clés
Médiation scientifique, émission télévisée, médiation des savoirs, science-société, Saps, observation participante.
In English
Title
Making a University-lead Science Communication TV Program: Actor Dynamics and Outreach Challenges
Abstract
La Grande Enquête!, a television program at the heart of the MérLin Project—led by the University of Lille under the SAPS label—demonstrates the growing involvement of universities in science communication. As members of its editorial board, our team of communication sciences researchers was able to participate in the conception and production of this scientific television program, and to observe the complexities of its editorial dynamics, resulting from the partnership between the university, a television channel, and a scientific culture association. Using a mixed-method approach that combines semi-structured interviews with project stakeholders, participant observation, and an analysis of the episodes, the study examines the editorial construction and the dissemination of scientific knowledge within a television program co-produced in an academic context.
Keywords
Science communication, television program, science outreach, science-society relationship, Saps, participant observation.
En Español
Título
Concebir un programa de divulgación científica a nivel universitario: lógicas de actores y retos de mediación.
Resumen
La Grande Enquête!, programa de televisión central al Proyecto MérLin— conducido por la Universidad de Lille en el marco del Labell SAPS—demuestra la creciente implicación de las universidades en la divulgación científica. Como miembros del comité editorial, nuestro equipo de investigadores en ciencias de la comunicación ha podido participar a la creación y producción de este programa y observar las complejas dinámicas editoriales de un objeto audiovisual que asocia la universidad, un canal de televisión y una asociación de cultura científica. Utilizando un enfoque metodológico mixto que combina entrevistas con los actores del proyecto, observación participante y un análisis de los episodios, el estudio examina la construcción editorial y la difusión del conocimiento científico en un programa de televisión coproducido en un contexto académico.
Palabras clave
Divulgación científica, programa de televisión, difusión del conocimiento, ciencia y sociedad, Saps, observación participante.
Pour citer cet article, utiliser la référence suivante :
Adrianzen Lapouble Claudia, Bolka-Tabary Laure, Kergosien Éric « Concevoir une émission de médiation scientifique à l’échelle d’une université : logiques d’acteurs et enjeux de médiation », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n°25/1, 2025, p.40 à 53, consulté le mardi 24 février 2026, [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2025/dossier/04-concevoir-une-emission-de-mediation-scientifique-a-lechelle-dune-universite-logiques-dacteurs-et-enjeux-de-mediation/
Introduction
En avril 2021, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) a lancé le label « Science avec et pour la société » (Saps). Ce label, issu de la loi de Programmation de la Recherche (LPR) de 2020, vise à intégrer la relation science-société comme une dimension essentielle de l’activité scientifique et des carrières académiques. Il permet à la fois de reconnaître et de valoriser l’engagement des sites et d’attribuer des dotations pour des investissements universitaires dans ce domaine. Les universités lauréates de ce label sont ainsi appelées à s’engager activement dans la diffusion et le partage des connaissances, notamment auprès de publics non universitaires (Minault et al, 2021). Dans ce contexte la médiation scientifique apparait comme un aspect clé des actions en matière de science-société, en témoigne le nombre de projets Saps1 centrés sur ces dispositifs, y compris la création de formations (diplômes universitaires, masters et unités d’enseignement destinées à des chercheur·es et à des doctorant·es).
Cet article porte sur le rôle des universités dans la médiation scientifique à travers l’étude de cas du projet MérLin. Porté par l’Université de Lille dans le cadre du Label Saps, il a pour objectif de fédérer les actions et services – allant de la médiation scientifique aux sciences participatives – déjà en place à l’université tout en renforçant les liens entre celle-ci et ses partenaires régionaux. L’action phare du projet est une émission télévisée, La Grande Enquête ! (LGE), réalisée en partenariat avec la chaîne L’Esprit Sorcier TV (ES-TV) et l’association Ombelliscience (agence régionale de culture scientifique technique et industrielle des Hauts-de-France). La réalisation de cette émission illustre pour l’université le passage d’un rôle de soutien des actions de médiation à celui de pilotage et de responsabilité dans un projet de médiation scientifique, domaine jusqu’ici souvent externalisé ou pris en charge par des associations culturelles scientifiques (Bordeaux et Chambru, 2020).
Nous présentons ici une analyse de la dynamique des acteur·ices impliqué·es et les formes de médiation scientifique télévisée qui en résultent. Comment construire une émission en associant des acteur·ices aux visions variées ? Quelles formes de médiation émergent de cette collaboration ? Les données issues d’une observation participante, d’entretiens et d’une analyse sémiotique des trois premières émissions diffusées offrent la possibilité de comprendre quelle forme prend concrètement ce travail de médiation.
La Grande Enquête ! : un dispositif de médiation scientifique au sein d’un projet labellisé
La Grande Enquête ! est marquée à la fois par les injonctions de l’appel à projets ministériel de son projet cadre et par les choix d’une politique universitaire qui cherche à structurer ses actions en matière de science et société.
Le projet MérLin
Lauréate de la deuxième vague2 de labellisations Saps en juillet 2022, l’université de Lille initie le projet MérLin (Médiation – reportages, Université de Lille, inspirons demain) en 2023. MérLin poursuit le double objectif de fédérer les différentes actions et services universitaires en matière de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) et de renforcer et étendre les partenariats de l’université pour toucher de nouveaux publics. L’université de Lille fédère, dans le cadre du projet, un collectif rassemblant des structures CSTI en région Hauts-de-France ainsi que des institutions du territoire (région, départements et communautés d’agglomération) en plus d’un réseau associatif régional et le monde éducatif. À ces institutions s’ajoute un écosystème universitaire qui associe les programmes « Les Sciences Infusent »3 et « Xpérium »4 , « La Boutique des Sciences »5 et la Maison pour la Science en Nord-Pas-de-Calais6 .
Les objectifs d’articulation, de mise en valeur d’actions existantes et de potentialisation de partenariats de MérLin, s’inscrivent dans la continuité de la politique universitaire en matière de science et société. Cependant, certains aspects du projet visent à répondre aux critères spécifiques de l’appel à projets Saps. C’est notamment le cas des partenariats, indispensables pour comprendre les tenants et les aboutissants de la mise en œuvre de La Grande Enquête ! En effet, l’un des quatre critères principaux de l’appel est un partenariat avec des professionnel·les du territoire, pouvant « inclure tout ou partie des acteurs suivants : les professionnels de la médiation scientifique et culturelle locaux (musées, association, etc.), des médias locaux et/ou nationaux ; les acteurs du tissu économique7 ». MérLin répond à ce critère en associant à la fois un média et une association. Si La Grande Enquête ! (LGE !) s’appuie sur des partenariats, plutôt qu’uniquement sur des structures internes, ceci est a priori moins en raison d’un choix institutionnel – qui pourrait refléter soit les usages de l’université, soit un manque de compétences en interne – que des injonctions de l’appel à projets.
Par ailleurs, le choix d’un dispositif de médiation scientifique comme action structurante du projet est, d’après nos entretiens, à la fois le résultat d’un souhait de certains des membres du comité Saps et le produit des circonstances. En effet, la chaîne ES-TV8 a été invitée à présenter son projet éditorial lors d’une réunion avec des vice-présidents et les chargé·es science-société peu avant la date boutoir de la deuxième vague de labellisations Saps. Ainsi, six universités labellisées figurent comme des « partenaires » sur le site de la chaîne9 . La nature de ces partenariats est diverse, allant de l’intervention de chercheur·es dans des émissions à la coopération technique10 en passant par la co-production d’émissions ponctuelles. Seul le partenariat avec l’université de Lille semble à ce jour s’être consolidé dans un programme au format récurrent et avec une périodicité plus ou moins constante (une émission par semestre).
La Grande Enquête ! : entre dispositif de médiation et catalyseur de partenariats
Présentée comme un « concept inédit de médiation scientifique globale »11 , l’émission repose sur le principe de faire dialoguer chercheur·es et citoyen·nes12 autour d’un sujet (intelligence artificielle, gestion de la ressource en eau, sciences du sport et inégalités). Dans son format initial, l’émission se structure à partir d’une enquête menée par des doctorant·es de l’université auprès de personnes aux profils variés pour recueillir – sous forme d’entretiens inspirés des méthodes socio-ethnographiques – leurs visions sur le sujet traité dans l’émission. Animée par le journaliste Frédéric Courant, elle prend la forme d’un talk-show, rythmé par des reportages, tourné dans les conditions du direct, où des chercheur·es de l’université – et éventuellement d’autres intervenant·es issu·es de la société civile – s’expriment sur le sujet à la lumière des travaux scientifiques récents et en cours.
Elle est pensée pour être réalisée dans une dynamique collaborative avec les partenaires intra- et extra-universitaires. Au sein de l’université, le service audiovisuel (La Dosima) collabore avec l’équipe d’ES-TV pour le tournage, le montage de l’émission et la réalisation de certains reportages. Participent également les différents acteurs universitaires porteurs d’actions et projets dans le périmètre Saps : le service de valorisation de la recherche (qui porte deux pôles CSTI : « Les sciences infusent » et la « Boutique des sciences ») ; le pôle « médiation » du réseau de bibliothèques : « Xpérium » ; la Direction culture et la Maison pour la Science en Nord-Pas-de-Calais13 . Le rôle et la participation de ces services varient selon les émissions, allant de l’aide à l’identification d’expert·es jusqu’à l’organisation d’actions pour les terrains d’enquête et de tournage. En plus de ces acteurs, à chaque nouvelle émission, un.e ou des chercheur·es (expert·es) spécialistes du sujet traité sont mobilisé·es. L’ensemble de ces acteurs, à l’exception de la Dosima, constitue le comité de rédaction de l’émission, auquel participe également notre équipe de chercheur·es en sciences de l’information et de la communication, ainsi que les deux partenaires extra-universitaires, la chaîne l’ES-TV et l’association Ombelliscience. La volonté de faire de LGE ! une émission construite de manière collégiale par des universitaires, un média et le monde associatif s’affirme donc à toutes les étapes de sa réalisation, tant d’un point de vue technique qu’éditorial et est mis en avant dans le projet déposé en vue de la labellisation.
Ce contexte permet d’appréhender LGE ! comme une action dont les objectifs institutionnels dépassent la seule finalité de médiation et de diffusion des sciences, étant aussi un dispositif stratégique visant à renforcer les partenariats au sein d’un projet Saps. Ce positionnement soulève des enjeux qui influencent directement la dynamique éditoriale de l’émission, complexifiée par la volonté de faire converger une telle diversité d’acteurs.
Une dynamique éditoriale complexe
Dès le début du projet, notre équipe a été sollicitée pour l’accompagnement scientifique de l’enquête servant de fil conducteur à l’émission14 . Ainsi, notre implication ne sollicitait pas directement nos champs d’expertise scientifique mais nos compétences méthodologiques. Cette situation, que décrit également Marie-Christine Bordeaux (2020), confirme bien que les sciences de l’information et de la communication sont souvent invitées à jouer un rôle d’accompagnement plutôt que de production d’une analyse distanciée des débats scientifiques. Cela-dit le comité de pilotage du projet nous a autorisé à mener la collecte de données nécessaire à notre étude de la dynamique éditoriale, qui dépasse ainsi les seules missions opérationnelles du projet. Notre équipe a ainsi pu investir le Projet MérLin dans une perspective de recherche-action (Allard-Poesi et Perret, 2003), participant à la réalisation de l’émission tout en observant la dynamique d’acteur·ices qui se développait dans ce processus de construction d’un dispositif de médiation scientifique.
Pour comprendre cette dynamique, nous avons combiné une observation participante des différentes réunions et une série d’entretiens semi-directifs avec 12 chargé·es des services ou des structures universitaires participant au projet15 . Les entretiens, d’une durée moyenne de une heure, ont été réalisés entre avril et mai 2024. La grille d’entretien visait à explorer leurs perceptions du projet MérLin et leur participation à la construction de l’émission. Les répondant·es étaient des responsables des dispositifs et services des CSTI impliqués dans la réalisation de l’émission, ainsi que des personnes chargées du pilotage du projet, dont le vice-président chargé des relations sciences société. De profils variés, ces personnes ont une expérience et une proximité diverses avec les activités de recherche et de médiation. Ainsi, seulement trois d’entre eux sont des enseignant·es-chercheur·es, dont un·e particulièrement impliqué·e dans la médiation scientifique. La plupart des interviewé·es (cinq) sont des professionnel·les des CSTI, dont deux ont déjà exercé des activités de recherche avant une reconversion. Finalement, trois gestionnaires de l’université complètent notre panel, dont une personne ayant eu déjà une expérience de recherche ; ces gestionnaires sont des professionnel·les avec une longue expérience dans des structures universitaires, mais sont pour la plupart d’entre elles et eux, détaché·es pour la première fois à des missions liées aux CSTI. Les entretiens ont été croisés avec nos observations pour analyser les interactions au sein du comité de rédaction. Les résultats ont, en outre, servi à nourrir l’analyse des trois émissions déjà diffusées au moment de l’enquête.
Une dynamique supportée par des points de vue et des intérêts divers
Si toutes les personnes interviewées s’accordent sur la qualité scientifique et technique des émissions produites, qui mettent en avant la richesse des travaux de recherche menés au sein de l’université, il ressort également que la diversité des acteurs·ices impliqué·es enrichit le projet tout en complexifiant sa réalisation. Chacun·e porte en effet des perspectives et des intérêts différents, parfois difficiles à concilier. Cette diversité de priorités crée des tensions a priori inévitables, notamment en ce qui concerne la définition des objectifs de la médiation scientifique et leur place dans l’émission. Un exemple de désaccord est la mise en avant des actions de médiation des porteurs Saps dans l’émission : alors que, pour l’université, intégrer ces actions dans l’émission et valoriser les services semblait compatible avec les objectifs Saps, le média partenaire a souhaité focaliser l’attention sur la recherche et ses résultats.
Un autre aspect est que, la participation d’acteur·ices « fixes » (présents à chaque édition) et « ponctuels » (invités pour une émission spécifique) influence fortement la dynamique éditoriale. Pour chaque émission, les expert·es désigné·es sont invité·es à formuler des préconisations qui vont au-delà du seul contenu scientifique. Ceci se répercute dans l’émission finale, qui est, pour partie, le résultat d’une vision « située » de la médiation par ces « expert·es ». Certain·es expert·es ont ainsi choisi de construire l’émission sans la participation de doctorant·es et en n’intégrant pas la réalisation de l’enquête sur les représentations des citoyen·nes.
Les thématiques choisies amènent également à solliciter de manière inégale les différents porteurs Saps. Par exemple, la direction de la culture, tout en faisant partie du comité Saps, n’a pas « encore pu se retrouver dans les thématiques »16 des émissions tandis qu’ « Xpérium » a participé activement à trois des quatre émissions réalisées, l’édition « Les sciences du sport » ayant été entièrement construite à partir des stands de leur saison 5 (2022-2024, « Va y avoir du sport ! ») consacrée aux recherches autour de la pratique sportive.
Pilotage et mobilisation des porteurs Saps
Au-delà de la diversité des visions et des attentes des acteur·ices, une autre difficulté réside dans ce que l’une des personnes interviewées nomme un « pilotage non autoritaire », qui, d’après elle, complique la consolidation d’une organisation cyclique pour la réalisation des émissions.
« Chaque émission est presque une nouvelle émission, un nouveau type d’émission. (…) Cette gestion de projet n’a pas été normalisée, clairement pas. Ça a réagi au coup par coup. C’est presque un nouveau projet à chaque nouvelle émission »17
En effet, l’émission est organisée par un pilotage qui assure des missions de production (mise en contact, viabilisation logistique des lieux de tournage, etc.). Ce pilotage laisse une large place au comité de rédaction mais présente également une opacité sur certaines étapes, par exemple celle de la sélection des expert·es scientifiques pour chaque émission. Il n’est pas rare que des étapes impliquant une partie des acteurs ne soient pas visibles pour les autres.
Ceci contribue à créer une dynamique jugée à la fois « coûteuse » et « chronophage » par un·e interviewé·e. En plus de cela, le fait que ces dernier·es ne soient pas sollicité·es à chaque cycle génère une relation de coopération peu engageante. Cette tendance s’est accentuée au fil des émissions : l’enthousiasme initial suscité par la première émission, qui avait mobilisé presque tou·tes les services et les structures CSTI universitaires ainsi qu’un grand nombre de chercheur·es, (dont des doctorant·es), s’est peu à peu estompé lors des émissions suivantes. L’émission sur les inégalités, par exemple, a été réalisée sans leur participation et sans enquête, s’appuyant uniquement sur le travail de l’équipe d’expert·es et l’ES-Tv.
Certain·es responsables interviewé.es voient ainsi le dispositif comme une initiative de l’université à laquelle ils et elles sont invité·es à participer, plutôt que comme une action collective. De plus, certain·es d’entre elles et eux estiment que leur contribution n’est pas suffisamment valorisée dans l’émission, ce qui les amène également à limiter leur implication :« Quand on regarde bien l’émission, il y a très peu de contributions des pilotes et des porteurs Saps habituels. C’est un nouvel objet à part entière. »
De même, un·e autre interviewé·e met en avant le sentiment de coopérer pour une action dont, finalement, son service ou sa structure ne trouve pas de contrepartie mesurable ou du moins à la hauteur des ambitions que le projet porte. Ainsi, au sujet de la capacité fédératrice de LGE !, la plupart des interviewé·es ont un avis mitigé. Si, le projet MérLin a amené les différents acteur·ices du projet Saps de l’université à se rencontrer de manière plus fréquente qu’auparavant et parfois à mener par la suite des projets communs, l’expérience de leur participation à l’émission est décrite comme limitée.
Plusieurs caractéristiques du dispositif expliquent cela : un choix politique de sujets émanant directement de la présidence de l’université ou encore le choix de fonder l’émission en grand partie sur l’existant en matière de médiation. Quoiqu’il en soit, ce désengagement reflète une vision, partagée par la plupart des responsables CSTI, selon laquelle l’émission serait devenue un dispositif ayant pris trop de place au sein d’un projet pensé comme n’étant pas résumé à la seule réalisation de l’émission. Aussi, les contraintes du financement ont amené à concevoir la labellisation comme une incitation à créer de nouveaux dispositifs pour des services et structures portant déjà de nombreuses actions de médiation scientifique, parfois peu visibles. De même, l’argument du coût élevé de l’émission au regard du retour sur investissement revient souvent dans les interviews. Les porteur·es déplorent que des telles ressources soient mobilisées pour une action pour laquelle, à leurs yeux, « on ne peut pas voire facilement le retour, on ne connait pas les chiffres. Qui regarde finalement l’émission ? »
Le partenariat avec L’ES-TV
Du côté de l’ES-TV, il a fallu maintenir une unité et une cohérence dans le programme malgré les contraintes voire les blocages rencontrés lors de la préparation. Par exemple, pour les deux dernières émissions produites, il a fallu composer avec l’absence de doctorant·es ou d’enquête découlant des suggestions des expert·es. Coté université, les exigences techniques et éditoriales du média ont parfois été difficiles à concilier avec les contraintes des services universitaires et des chercheur·es. Certain·es interviewé·es estiment d’ailleurs que l’université a bénéficié d’une marge de manœuvre trop réduite dans le choix du format. Ces contraintes, ainsi que l’expérience du média, ont toutefois amené à l’université des modalités de travail qui pallient la complexité et les difficultés internes d’organisation par des attentes claires :
« Ça fonctionne quand même parce que l’esprit sorcier rattrape le coup (…). Je l’ai vu dans des réunions. Quand quelqu’un de l’esprit sorcier, Fred par exemple, arrive dans une réunion en disant, je caricature volontairement, arrêtez vos débats stériles, nous il nous faut ça, ça, ça, à telle date, maintenant envoyez-nous, sinon l’émission ne se fera pas. À un moment, ça lisse un petit peu le process. »
Mais l’absence d’un référent « médiation scientifique » côté université limite la mobilisation et la consolidation des compétences internes en plus de signifier, en pratique, que le travail de médiation est délégué au média partenaire et aux chercheur·es. De ce fait, force est de constater que malgré les efforts institutionnels en matière de pilotage, en termes de médiation des sciences LGE ! ne consolide pas un changement important de la place occupée par l’université dans la conception de tels objets.
Ceci soulève des questions quant à la suite de cette dynamique de médiation, une fois le partenariat avec le média terminé. Les enqueté·es avancent en effet que « l’université ne sait pas faire de la télé » et que « faire de la vulgarisation est différent de faire une émission de télé qui parle de vulgarisation ». L’université dispose en effet de technicien·nes audiovisuels, de professionnel·les de la médiation et de chercheur·es capables de vulgariser les travaux scientifiques, toutefois la médiation audiovisuelle sous forme d’émission relève de compétences journalistiques qui, d’après les interviewé·es, ne sont pas présentes en interne :
« Il manque la petite touche journaliste, émission de télé, ce que nous on ne sait pas faire. Donc ils sont arrivés avec cette valeur ajoutée-là et le font bien, je pense. Tous ceux qui ont collaboré avec L’Esprit Sorcier sur cet aspect-là sont contents. L’enjeu, ce n’est pas que de faire de la vulgarisation, c’est de faire une émission de télé. C’est un métier. Ce n’est pas dans mes compétences ni dans celles de mes collègues. »
Ainsi, la complexité de la dynamique éditoriale de LGE ! révèle les tensions inhérentes à la mise en œuvre d’un projet qui compose avec des intérêts et des priorités diverses. Celle-ci se constitue dans deux niveaux d’interaction. Le premier, d’ordre institutionnel, concerne l’université et le média partenaire, et est marqué par les attentes diverses et la difficulté à faire converger des temporalités et visions stratégiques de l’émission. Le second, d’ordre opérationnel, et que nous avons plus longuement traité ici, s’observe dans la difficulté de consolider une dynamique cyclique de réalisation pour chaque émission. L’implication inégale des structures CSTI de l’université, les divergences de visions et les contraintes liées au partenariat avec L’ES-TV ont façonné un dispositif où l’université, malgré ses efforts, peine à s’imposer en tant qu’acteur central de la médiation scientifique. Cette dynamique se répercute dans l’émission en tant qu’objet télévisuel.
La Grande Enquête ! : renouvellement du format de l’émission scientifique ?
Les spécificités de la dynamique éditoriale de LGE ! produisent-elle finalement un format original, voire novateur, de médiation scientifique ? Nous avons observé ce que ces dynamiques de collaboration génèrent à l’écran en effectuant une analyse sémiotique des trois premières émissions : « Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ? »18 (février 2023) [émission 1] ; « L’eau : bientôt une denrée rare ? »19 (novembre 2023) [émission 2] ; « Les sciences du sport » 20 (janvier 2024) [émission 3]. Notre approche permet de mettre en regard la conception collaborative de l’émission et l’objet audiovisuel final. Elle vient ajouter une perspective complémentaire aux travaux en SIC sur la médiation audiovisuelle des sciences, qui privilégient une approche diachronique et dispositive des formats, de la mise en forme et de la mise en scène de la science. Les chercheur·es ont ainsi d’observé le discours sur la science au prisme du dispositif qui l’énonce (Babou et Le Marec, 2003), l’évolution des formats autour du traitement d’une même thématique (Guéraud-Pinet, 2022) ou encore la mise en discours et en images du travail des chercheur·es (Bolka-Tabary, 2021 ; Carnel, 2022). Ces travaux ont mis en lumière la diversité des modes de monstration de la recherche scientifique mais plus marginalement l’évolution de la place des chercheur·es dans ces émissions.
Pour cette analyse, nous nous sommes concentré·es sur les traces d’un travail en commun entre universitaires, traces explicitées dans les émissions (dans le discours ou dans les images) et les marqueurs stylistiques et narratifs de cette collaboration (distribution de la parole, mise en images des sciences, distribution de l’espace et interaction des sujets dans et avec ces espaces). La grille adoptée emprunte à des méthodes des visual studies (Mitchell, 1994) et aux travaux de François Jost (1999) et cherche à observer à la fois des éléments formels et des aspects liés au contexte de production et réalisation (incluant les objectifs de médiation qui orientent les contenus, mais aussi les contraintes liées aux financements) de ces programmes dans le but d’observer leur interdépendance. Nous faisons le choix ici de concentrer nos observations sur le plateau et de traiter partiellement des reportages qui constituent aussi des éléments importants de l’émission.
Une structure mettant en valeur l’enquête
LGE ! est diffusée sur la tranche « prime » (21h10) de la chaîne L’Esprit Sorcier TV, puis mise en ligne sur YouTube. Les émissions suivent, à quelques détails près, la même structure. Une introduction avant générique ouvre l’émission : face-camera, le présentateur annonce le thème. Cette séquence fournit, en outre, un aperçu des décors et de la présence d’un public. Viennent ensuite les génériques (cf. figure 1) qui laissent apparaître les logos des institutions partenaires et des financeurs. La séquence post-générique développe l’introduction. Le présentateur y explique le principe de l’émission – l’enquête servant de fil conducteur – puis invite et présente les premier·es intervenant·es et les doctorant·es-enquêteur·rices avant d’enchainer sur la première partie de l’émission.
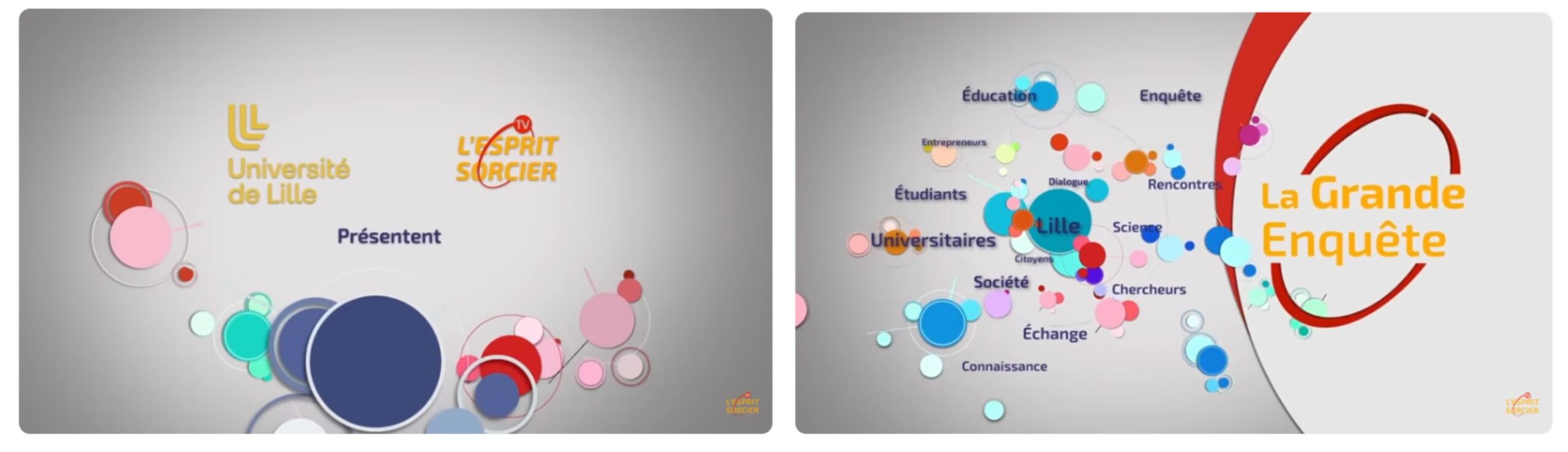
Figure1. Photogrammes du générique de l’émission
L’émission est organisée en blocs (entre 3 et 4 par émission) correspondant à des sous-thèmes. En principe, ces blocs sont dérivés des résultats de l’enquête et sont rythmés par un ou deux reportages dans le but d’illustrer le sujet ou de donner à voir les scientifiques dans leurs terrains ou dans leurs laboratoires. Un·e scientifique en plateau est ensuite invité·e soit à compléter soit à réagir. Les blocs sont introduits par des « points-enquête », procédé de narration permettant de rappeler au spectateur l’importance de l’enquête dans la construction du conducteur et de faire émerger les résultats les plus pertinents en lien avec la sous-thématique en question. Dans les deux premières émissions, ces « points-enquête » sont accompagnés d’un montage d’images tournées sur les terrains où l’on donne un aperçu des témoignages et impressions recueillis.
Le discours du présentateur s’attache particulièrement à rendre compte du processus d’enquête à l’origine du titre de l’émission. Un reportage en début d’émission y est d’ailleurs consacré pour les émissions 1 et 2. À la fois sur le plateau, dans les discours des chercheur·es de notre équipe et des doctorant·es, le processus d’enquête est décrit, depuis sa méthodologie jusqu’au traitement des résultats, en passant – hormis l’émission 3 – par la formation des doctorant·es et leurs retours sur les difficultés et l’apport des entretiens
Cette mise en valeur de l’enquête dans l’émission est révélatrice de l’importance donnée, par le média, aux spectateur·ices. En effet, Joëlle Le Marec et Igor Babou (2003) ont observé que les émissions télévisées scientifiques veulent souvent inclure les paroles et images d’un public « profane ». Ce procédé, symptomatique de l’évolution des talk-shows vers des formats valorisant la « parole ordinaire » (Jones, 2016), permet aux spectateur·ices de se projeter dans un contenu a priori exigeant sur le plan intellectuel en s’y sentant représenté·es et d’atténuer la distance entre elles et eux et les scientifiques.
D’autres aspects de l’émission ont sensiblement évolué. Pour les deux premières émissions, les doctorant·e·s-enquêteur·ices sont invité·es à intervenir sur le plateau : alors que pour l’émission 1 ils et elles s’expriment davantage sur leur expérience d’enquêteur·rices, pour l’émission 2 ce retour d’expérience n’est pas exploré et ils et elles prennent la parole pour évoquer leurs propres recherches. Ainsi, l’identité médiatique des doctorant·es évolue, leur rôle communicationnel passant de celui d’acteur·ices dans la première émission à celui d’expert·es dans la deuième. Dans l’émission 3, l’absence de doctorant·es constitue une rupture significative, leur présence se limitant à l’interview d’un jeune chercheur en sociologie dans un reportage.
En outre, en fonction des choix du comité de rédaction, ce qu’il est possible d’observer au cours des trois émissions est un effacement progressif de l’enquête, pourtant à l’origine mise en avant comme centrale dans l’émission. Outre des changements d’ordre éditorial et formel (absence des « points-enquête » et des enquêteur·ices sur le plateau), cela se traduit par une perte d’espace des personnels universitaires dans le rôle médiatique d’acteur·ices de l’émission. Ainsi, si lors des deux premières émissions, une chercheure de notre équipe endossait le rôle médiatique d’actrice de l’émission en présentant les résultats de l’enquête, pour la troisième émission ce rôle revient à une journaliste du média partenaire jusqu’à disparaître dans la quatrième émission où l’enquête est supprimée.
L’université, invitée de sa propre émission ?
D’autres éléments, visuels, discursifs et inhérents au dispositif télévisuel lui-même, font de La grande enquête ! une émission où l’université semble occuper une place plutôt conventionnelle d’invitée (Babou et Le Marec, 2003).
Pour les spectateur·ices, la dynamique de co-conception impliquant unités de recherche, services de médiation, média et association est peu visible à l’écran. En introduction et en conclusion, des éléments de langage et d’affichage en rendent compte de manière brève et factuelle. S’affichent ainsi chronologiquement à l’écran le soutien du ministère et du label Saps puis la participation d’Ombelliscience. L’université de Lille et ES-TV sont ensuite mis sémiotiquement sur le même plan comme étant à l’origine de l’émission à l’aide de la mention « présentent » (cf. figure 1). Celle-ci, imprécise, vient compléter, dans les crédits finaux, la citation de l’ensemble des acteur·ices impliqué·es qui précisent leur fonction ainsi que leur rattachement institutionnel, précédés de la mention « une émission préparée par ». En conclusion de l’émission 1, le présentateur adresse quelques remerciements directs, qui visent davantage les partenaires que les téléspectateur·ices extérieurs à l’université qui se verront contraint·es de lire l’ensemble des crédits pour savoir de qui il s’agit. Le partenariat est donc acté à l’écran mais pas clairement présenté – et encore moins décrit – dans le discours.
Parmi les éléments liés au dispositif, la figure du présentateur est ici celle d’une personnalité connue des téléspectateur·ices français·es. Fred Courant est un « vulgarisateur » vedette, connu pour sa participation à l’émission culte « C’est pas sorcier ». Diffusée entre les années 1990 et début des années 2000, elle est ancrée dans la mémoire audiovisuelle des Français·es et constitue une référence parmi les émissions scientifiques (Denis, 2016). Il est ainsi fort probable que le téléspectateur·ice voit La Grande Enquête ! comme « une émission de Fred », réalisée par son équipe et diffusée sur sa chaîne, plutôt que comme une émission universitaire. Ceci est renforcé par le format talk-show, où le présentateur occupe de fait une position centrale, distribuant et organisant les temps de parole.
L’organisation du plateau – différent pour chaque émission – répond à ce format et sa dynamique de parole distribuée. Il compte au moins deux espaces – celui des invité·es et celui du présentateur – dans une configuration où ce dernier est le seul personnage mobile, se déplaçant entre les différents espaces occupés par les intervenant·es. L’espace des invité·es varie en fonction de leur nombre et des contraintes du lieu de tournage. Ainsi, le plateau de l’émission 1, qui comprend le plus grand nombre d’intervenant·es, est organisée en trois espaces (cf. figure 2) avec d’un côté, deux rangs de tables pour les enqueteur·ices et d’un autre, un rang de tables pour les autres intervenant·es.

Figure 2. Plateau de l’émission 1 à Lilliad Learning Center
Notre collègue chargée de restituer l’enquête occupe une place « fixe » entre ces deux pôles d’intervenant·es. Les deux autres émissions partagent cette même organisation polycentrique du plateau, même si les agencements diffèrent.
Sur le plateau, la parole se répartit de manière différente lors des trois émissions, reflet des changements éditoriaux que nous avons mis en évidence. Lors de la première émission, le nombre considérable d’intervenant·es conduit à constituer un panel « changeant ». Ainsi, au retour des reportages, les spectateur·ices retrouvent un nouveau panel d’invité·es sur le plateau. Ce même procédé est utilisé lors de la troisième émission. Seule la deuxième émission adopte un plateau fixe dans lequel tou·tes les intervenant·es sont présent·es pendant toute la durée de l’émission.
Finalement, les lieux où les plateaux ont été installés sont porteurs d’une certaine charge symbolique. Ainsi dans l’émission 1 sur l’IA, c’est l’espace universitaire, Lilliad Learning Center, qui se transforme en plateau ; l’émission 2 sur la ressource en eau est tournée dans les locaux de la Métropole Européenne de Lille (Mel) qui finance de nombreux travaux sur ce sujet ; l’émission 3 sur le sport est tournée au Vélodrome de Roubaix (STAB). Pour les deux dernières émissions, ces choix découlent « naturellement » des thématiques et des partenariats de l’université : on parle de sport dans un vélodrome, d’intelligence artificielle sur le campus universitaire « Cité scientifique » accueillant les formations en sciences et technologies, de gestion de la ressource en eau dans les locaux de l’administration publique. Cela dit, ce choix implique également que le statut d’invitée ou de coopératrice plutôt que de co-créatrice de l’émission revêtu par l’université semble renforcé dans les émissions qui sortent des espaces universitaires.
Conclusion
L’analyse de La Grande Enquête ! rend compte de dynamiques complexes et parfois paradoxales, tant dans la conception et dans la réalisation de l’émission que dans la place qu’y occupent les différent·es acteur·ices, en particulier celles et ceux de l’université de Lille. Ceci met en lumière les tensions et les défis liés à la création d’une émission de médiation scientifique au sein d’un projet universitaire. Malgré l’ambition initiale de construire un programme télévisé avec la participation active des chercheur·es et des services universitaires, le résultat final témoigne d’un écart entre cette intention et la réalité de la production.
Nos observations révèlent une dynamique dans laquelle la médiation scientifique semble finalement avoir été déléguée au média partenaire. Cette délégation n’exclut pas les universitaires des choix éditoriaux, mais transparaît dans l’émission finale, qui ne rend pas compte explicitement de ce rôle atypique joué par une université dans une production médiatique. Ainsi, au lieu d’une émission construite de manière collaborative par des chercheur·es et des services universitaires, l’objet final montre un panel relativement classique de scientifiques invité·es, sans mettre en scène l’existence d’une dynamique de rédaction collective. Cette situation illustre bien les difficultés rencontrées pour concilier les divers intérêts et temporalités des services et structures impliqué·es, qui a conduit à une division du travail où l’université joue un rôle de fournisseuse de sources et de co-productrice plutôt que de co-créatrice.
En outre LGE ! soulève des questions fondamentales sur la médiation scientifique universitaire. Pour le média partenaire, l’enjeu est de créer une émission qui dépasse le simple rôle de vitrine pour l’université. Cependant, les services de médiation universitaire, peu sollicités pour leur expertise, perçoivent l’émission davantage comme un outil de valorisation que comme un véritable dispositif de médiation scientifique. Cette divergence reflète les débats persistants sur la médiation scientifique : s’agit-il de valoriser la recherche ou de diffuser la science de manière accessible au grand public ?
Réaliser une émission de télévision à l’échelle universitaire présente des défis complexes, notamment en termes de formats capables de surmonter les contraintes liées au média, au dispositif choisi et aux politiques institutionnelles. La question reste ouverte : l’université peut-elle et doit-elle véritablement devenir un acteur influent dans le paysage télévisuel, ou restera-t-elle cantonnée à un rôle secondaire ? Les expériences futures devront repenser les formats et les stratégies pour favoriser une véritable intégration des universitaires dans la production de contenus médiatiques, tout en surmontant les défis institutionnels et financiers qui se posent.
Notes
[1] N’ayant pas accès à des données officielles sur la portée des projets proposés par les universités lauréates, cette affirmation est fondée sur un travail de veille que nous menons depuis janvier 2024.
[2] Deux vagues, en novembre 2021 et en janvier 2022, ont labellisé 20 sites universitaires (8 pour la première et 12 pour la seconde). Une troisième vague de labellisation a été lancée en décembre 2023.
[3] https://sciencesinfusent.univ-lille.fr
[4] https://lilliad.univ-lille.fr/xperium
[5] https://rechercheparticipative.univ-lille.fr/la-boutique-des-sciences
[6] https://nordpasdecalais.maisons-pour-la-science.org/
[7] Appel à projets 2022 Labellisation « science avec et pour la société » (Saps), disponible sur : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/lancement-de-la-deuxieme-vague-de-labellisation-science-avec-et-pour-la-societe-83176
[8] Fondée par des anciens journalistes de l’émission « C’est pas sorcier », dont le présentateur Fred Courant et le réalisateur Pascal Leonard, L’Esprit Sorcier est d’abord un blog et une chaîne Youtube, puis lancée en décembre 2022 en tant que chaîne de télévision. Présentée comme « la chaîne de la science et l’environnement », l’ES-TV a un modèle économique basé dans les dons et les partenariats de co-production avec des établissements d’enseignement et recherche, avec lesquels la coopération va ainsi au-delà des aspects de contenus scientifiques, comme l’affirme la présidente de la Fondation Esprit Sorcier, Françoise Bellanger, lors de la soirée de lancement à Paris (disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=uoFgEErz2og&t=731s).
[9] L’université de Lille, l’université Paris Nanterre, l’université de Poitiers, PSL, l’université Paris-Saclay et l’université de Rennes. Or, le site web de la chaîne ne semble pas à jour car en plus de ces universités figure Hesam Université, dissoute en 2024.
[10] C’est le cas du partenariat avec l’université Paris Saclay, établi en 2022. Des étudiant·es et enseignant·es de la Licence Professionnelle Techniques du son et de l’image de l’IUT Cachan, participent à l’enregistrement de divers programmes.
[11] Projet Déposé pour le Label Saps, Université de Lille, 2022. Document non publié.
[12] Nous reprenons ici le terme mobilisé par les instances universitaires dans des documents internes décrivant le dispositif La Grande Enquête ! désignant des personnes de divers âges, métiers et profils socio-économique n’ayant pas de lien particulier avec le monde de la recherche, associatif ou professionnel.
[13] Ces acteurs font également partie du comité Saps, qui se réunit périodiquement et est impliqué dans les choix et la construction de la politique institutionnelle en matière de liens science-société
[14] Participation aux réunions du comité de rédaction, formation des doctorant·es aux méthodes d’enquête par entretien et encadrement de l’enquête, analyse et restitution des données d’enquête.
[15] Afin de respecter l’anonymat des interviewé.es, nous avons décidé, pour la présentation des résultats, d’anonymiser non seulement leurs noms mais également leurs fonctions.
[16] Communication personnelle, mai 2024
[17] Afin de respecter l’anonymat des interviewé.es, nous avons décidé, pour la présentation des résultats, d’anonymiser non seulement leurs noms mais également leurs fonctions.
[18] https://www.youtube.com/watch?v=me26dG9-gBg
Références bibliographiques
Allard-Poesi, Florence ; Perret Véronique. (2003), « La Recherche-Action », in Giordano, Yvonne (dir), Conduire un projet de recherche, une perspective qualitative, EMS, p. 85-132.
Babou, Igor ; Le Marec, Joëlle (2003), « Science, musée et télévision : discours sur le cerveau ». Communication & langages, p. 69-88, [en ligne], consulté le 15 juillet 2024, https://doi.org/10.3406/colan.2003.3238.
Bolka-Tabary, Laure (2012), « Le changement climatique à la télévision : de la science à la fiction », Communication & langages, p. 53 à 67, [en ligne], consulté le 15 juillet 2024, https://www-cairn-info.ressources-electroniques.univ-lille.fr/revue-communication-et-langages1-2012-2-page-53.htm
Bordeaux, Marie-Christine ; Chambru, Mikael (2020), « L’université, des liens à construire entre sciences et citoyens : évidence ou défi ? », Horizons Publics, Hors-série Citoyenneté et innovation : l’université Grenoble Alpes au cœur des grands débats de société, p. 38-44.
Carnel, Jean-Stéphane (2022), « Heureux qui, comme Rosetta, a fait un beau voyage : Analyse de la mise en récit sur TF1 d’un exploit scientifique (2004-2016) », Questions de communication, [en ligne] consulté le 15 juillet 2024, https://doi-org.ressources-electroniques.univ-lille.fr/10.4000/questionsdecommunication.30829
Denis, Romain (2016), La vulgarisation scientifique à la télévision française (1995-2003) à travers trois émissions : E=M6, C’est pas sorcier et Archimède. Mémoire de Master. Université de Lyon 2.
Guéraud-Pinet, Gyulaine (2022), « Formes et traitement médiatiques d’explorations : La médiatisation des origines de la vie et la vie extraterrestre à la télévision française et sur YouTube (1959-2018) ». Questions de communication, [en ligne], consulté le 15 juillet 2024, https://doi-org.ressources-electroniques.univ-lille.fr/10.4000/questionsdecommunication.29745
Jones, Jeffrey P. (2016), « Parole d’experts, public profane : les mutations du discours politique à la télévision », Questions de communication [En ligne], 24, 2013, mis en ligne le 01 février 2016, consulté le 16 janvier 2025, http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/8671
Jost, François, (1999). Introduction à l’analyse de la télévision, Ellipses, Paris 1999
Minault, Bertrand (dir.) (2021), Cartographie des actions conduites par les établissements d’enseignement supérieur (universités et écoles) en matière de relations entre science et société, Paris : Rapport au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Mitchell, W. J.Thomas (1994), Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago: The U of Chicago
Annexes
|
Tableau synoptique des émissions |
||||
|
Titre et URL |
Diffusion |
Durée |
Lieu de tournage |
Reportages |
|
Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ? |
1er Tv : 9/02/2023 à 21h10 Youtube : 10/02/2023 |
2h15 |
Lilliad Learning center 24/01/2023 |
5 |
|
L’eau : bientôt une denrée rare ? |
1er Tv : 18/12/2023 à 21h10 Youtube : 22/12/2023 |
2h13 |
Biotope – siège de la MEL (27/09/2023) |
9 |
|
Les sciences du sport |
1er Tv : 12/02/2023 à 21h10 Youtube : 16/02/2024 |
1h38 |
Vélodrome régional Jean-Stablinski, « Le Stab » 30/11/2023 |
5 |
|
Tous égaux, vraiment ? |
1er Tv : 23/09/2024* à 21h10 Youtube : 24/09/2024 |
2h01 |
Bibliothéque Sciences Po Lille 13/06/2024 |
4 |
*Un extrait de cette émission a été mis en ligne le lundi 24 juin à 17h30 sous le titre « « Voter sert-il encore à quelque chose ? »
|
Identité médiatique des personnes sur le plateau |
|||||||
|
Titre de l’émission |
Journalistes |
Universitaires acteur·ices de l’émission |
Expert·es universitaires |
Enquêteur·ices |
Acteur·ices médiation |
Autres acteur·ices |
Autres universitaires |
|
Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ? |
1 |
2 |
6 |
11 |
2 |
1 |
2 |
|
L’eau : bientôt une denrée rare ? |
1 |
1 |
2 |
7 |
0 |
4 |
0 |
|
Les sciences du sport |
2 |
0 |
5 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Tous égaux, vraiment ? |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
Auteurs
Claudia Adrianzen Lapouble
Docteure en SIC, Post-doctorante à l’Université de Lille, associée au laboratoire Gériico. Ses travaux portent sur la pratique cinématographique en contexte interculturel, à partir d’une approche de l’audiovisuel en tant que pratique culturelle complexe. Dans un axe de recherche complémentaire, ses recherches portent également sur les formes et formats audiovisuels dans le terrain de la médiation scientifique en France.
claudia.adrianzen-lapouble@univ-lille.fr
Laure Bolka-Tabary
Maîtresse de conférences HDR en SIC à l’Université de Lille et membre du laboratoire Gériico. À partir d’approches ethnographiques et sémiotiques, ses travaux portent sur les pratiques numériques ordinaires, les dispositifs de médiation scientifique et les dynamiques de circulation et d’interprétation des images numériques.
laure.bolka-tabary@univ-lille.fr
Éric Kergosien
Maître de conférences en SIC à l’Université de Lille et membre du laboratoire Gériico. Ses axes de recherche sont notamment l’information scientifique et technique, l’organisation des connaissances et l’analyse de l’appropriation de dispositifs numériques.
eric.kergosien@univ-lille.fr
Plan de l’article
La Grande Enquête ! : un dispositif de médiation scientifique au sein d’un projet labellisé
Une dynamique éditoriale complexe
La Grande Enquête ! : renouvellement du format de l’émission scientifique ?
Écrire à Claudia Adrianzen Lapouble
Écrire à Laure Bolka-Tabary
Écrire à Éric Kergosien
