France 2 et Radio-Canada : deux conceptions de la médiation
Pour citer cet article, utiliser la référence suivante :
Bernier Marc-François, Romeyer Hélène, « France 2 et Radio-Canada : deux conceptions de la médiation« , Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n°06/1, 2005, p. à , consulté le , [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2005/varia/03-france-2-et-radio-canada-deux-conceptions-de-la-mediation
Introduction
Différents médiateurs existent dans le secteur des médias que ce soit en presse ou en radio télévision. L’idée commune veut que ces médiateurs soient tous plus ou moins héritiers de traditions nord-américaines. Cet article se propose donc, à travers la comparaison des cas français et canadien, de souligner les ressemblances et différences de deux modèles.
En France, la médiation de la rédaction de France 2 s’exerce à travers une émission, tous les samedis après le journal télévisé. Ce programme autoréflexif donne la parole aux téléspectateurs venant exposer leurs griefs vis-à-vis de l’information de la chaîne et publicise ainsi une réflexion sur la responsabilité des journalistes et/ou du message télévisuel. Au Canada, l’ombudsman de Radio-Canada fonctionne plutôt comme un mécanisme d’imputabilité journalistique qui reçoit des plaintes, les analyse et se prononce quant à leur bien fondé. Ses décisions se retrouvent dans un rapport annuel qui s’est beaucoup transformé depuis 1993 : plus court mais beaucoup plus diffusé, notamment sur l’Internet.
Si certaines similitudes existent entre ces deux modèles, les divergences restent plus nombreuses. L’étude que nous proposons permettra ainsi de mettre en évidence que le rôle et la fonction de ces deux médiateurs ne sont pas identiques : le modèle canadien se rapprochant d’une procédure juridique, alors que le modèle français se contente d’un espace de débat.
L’Hebdo du médiateur sur France 2
L’exercice de la médiation dans les médias français reste une activité rare. Si quelques tentatives ont été faites dans la presse écrite, seul le médiateur du journal Le Monde a perduré. Lorsque France Télévisions se dote d’un médiateur en 1998, c’est une première pour l’audiovisuel. Cependant, si cette création s’est inspirée de la presse nationale, ou de l’exemple suédois (1), nous proposons ici un éclairage mettant en avant les conditions d’émergence spécifiques du cas français. Ces dernières nous permettront, à travers l’étude du rôle et du fonctionnement de la médiation de France 2, d’étayer l’idée selon laquelle le rattachement du cas français aux traditions nord américaines et scandinaves est somme toute hâtif.
Un contexte particulier de création
Si le médiateur de la rédaction voit le jour à France Télévisions, c’est d’abord parce qu’il a un fervent défenseur : Albert du Roy, alors rédacteur en chef. C’est lui qui porte le projet et demande à Didier Epelbaum (premier médiateur) d’étudier sa faisabilité à travers les cas existants à l’étranger. Cependant, ce projet n’aurait pas survécu au départ d’Albert du Roy sans le soutien de son successeur, et sans que la direction n’y ait entrevu une solution pour redorer l’image de l’information sur le service public. Enfin, sans la présence d’un public compétent et intéressé, l’émission n’aurait pas perduré jusqu’à aujourd’hui. La rencontre de ces trois éléments a abouti à une conception originale de la médiation : la création d’un espace public de débat.
Ainsi, en 1998, la rédaction de France 2 est en crise. L’audience de ses journaux télévisés est en baisse : loin derrière celle de son rival TF1 depuis 1986, l’écart se creuse depuis la fin de l’année 1996. Une nouvelle ligne éditoriale favorisant l’information de proximité mise en place en 1996 provoque l’opposition d’une certaine partie de la rédaction. De plus, les journalistes dans leur ensemble sont décrédibilisés par plusieurs affaires ayant marqué l’opinion publique : le faux charnier de Timisoara, la couverture de la guerre du Golfe, la crise des Balkans, etc. Selon Didier Epelbaum, certains journalistes de la rédaction pensent qu’il faut entamer une réflexion sur leur profession et ses pratiques, d’autres estiment qu’il faut renouer le dialogue avec le public pour le reconquérir et le pérenniser. Les dirigeants de la chaîne publique décèlent alors dans le projet d’Albert du Roy un intérêt stratégique de programmation. L’autoréflexivité répond ainsi à plusieurs logiques :
– face aux critiques et à la perte de crédibilité, la médiation introduit une dimension éthique au sein des rédactions (ou en annonce l’introduction) ;
– la médiation incarne également une stratégie de communication de l’entreprise France Télévisions en développant une volonté d’explication affichée et revendiquée, de contact avec les téléspectateurs. Jouant sur la transparence, sur l’implication et l’explication, cette stratégie de communication contribuait à donner une image de qualité à l’entreprise, et permettrait de concrétiser une interactivité recherchée avec le téléspectateur ;
– la médiation, enfin, incarnait à la fois un outil de démarcation du service public par rapport à ces concurrents du privé, et un domaine encore inexploré à la télévision.
Un véritable « impératif de communication » semble ainsi saisir la direction de France Télévisions, les journalistes et le public. Selon Eliséo Veron, la scène médiatique est un lieu qui lie identité télévisuelle et légitimité télévisuelle, ce à quoi répond bien la création de L’Hebdo du médiateur sur France 2. C’est d’ailleurs le rôle qu’assignait Albert Du Roy dès 1997 au futur médiateur, « destiné à redonner une identité forte à l’information sur la chaîne de service public ».
Autre élément nécessaire à la tenue de ce dialogue entre journalistes et téléspectateurs : l’acquisition par ces derniers de connaissances suffisantes sur la télévision, les pratiques professionnelles et les dérives journalistiques. Par un processus d’assimilation et d’agrégation, au fur et à mesure que le média devenait un objet social à part entière et par la multiplication des écrits critiques sur les journalistes ou les médias, une culture journalistique et télévisuelle s’installe. Dès lors, le public dispose d’une compétence à s’exprimer sur le média et d’une volonté de le faire : un réel intérêt et une volonté des citoyens existent. L’augmentation des courriers reçus par le service de médiation de France Télévisions en atteste : de 9 000 courriers environ en 1999 à 35 204 courriers électroniques en 2003.
La prolifération d’associations de citoyens souhaitant débattre de la qualité de l’information depuis une dizaine d’années vient encore confirmer cette volonté participative : Les pieds dans le paf, Acrimed, Tocsin, Aqit, etc. Enfin, par l’intégration progressive des techniques d’information et de communication numériques comme l’Internet, ce téléspectateur dispose de moyens techniques pour dialoguer.
C’est d’ailleurs la spécificité introduite par l’autoréflexivité que cette place importante faite à une parole que nous pourrions qualifier de profane : celle du public. Cette parole du public, cette interactivité voulue et stimulée avec lui est un élément incontestablement favorable à la mise à l’antenne de L’Hebdo du médiateur. Et si ce mouvement est à replacer dans une évolution plus générale de la télévision des années 1990 qui voit l’émergence de la parole ordinaire, elle n’en reste pas moins surprenante au sein d’une profession peu disposée à la critique, surtout de la part de non professionnels. En effet, même si beaucoup d’évolutions ont marqué leur champ professionnel, les journalistes s’investissent toujours dans la mission civique que revendiquaient les écrivains : former, incarner l’opinion publique éclairée. D’autant plus quand il s’agit de parler des médias et de l’information. Il est donc surprenant de les voir accepter la critique de leur profession, et surtout de publiciser cette critique à travers une émission. Cette dernière, née de la conjonction d’une prise de conscience des professionnels, d’une culture de la critique bien ancrée et de la nécessité de faire face à une crise de crédibilité pour les médias, est donc à concevoir à la fois comme un outil de communication pour l’entreprise France Télévisions et une volonté, si ce n’est éthique, au moins d’écoute et d’interactivité avec le public. Ces deux éléments ont bénéficié d’un mouvement social parallèle, la volonté participative des citoyens, mouvement qui dépasse le seul cadre des médias. Cette congruence de facteurs a donné naissance à une médiation conçue comme un espace de débat.
Nomination et étendue de la fonction
Le médiateur de la rédaction de France 2 est nommé par le Président de France Télévisions. Ce dernier opère un choix parmi trois personnes sélectionnées par un collège représentant les syndicats et la Société des journalistes de France 2. Nommé initialement pour deux ans, le médiateur est indépendant de la rédaction. Selon la présentation faite en 2000 par Didier Epelbaum sur le site Internet de France 2, le médiateur est « l’interlocuteur et l’interprète du public auprès des journalistes de France 2. Sa mission est de clarifier le travail de la rédaction et, le cas échéant, de critiquer et de corriger les erreurs ». Didier Epelbaum, premier médiateur de France 2 de 1998 à 2000, précise en entretien : « Je suis médiateur c’est-à-dire la personne qui fait le lien entre une entreprise, la rédaction de France 2 en l’occurrence, et son public (…). On me demande de régler les problèmes entre ma société et mon public ». Jean-Claude Allanic, médiateur depuis 2000 insiste, lui, sur la dimension de dialogue : « Le rôle de l’émission est d’abord d’ouvrir un dialogue entre le public, les téléspectateurs et les journalistes. Donc le public pose des questions, émet des critiques (…) les journalistes écoutent ces opinions et ces critiques. (…) ça c’est le côté ‘remontée du téléspectateur vers l’émission’, mais l’objet de l’émission c’est aussi l’inverse : expliquer qu’on a fait une erreur (…) mais c’est aussi parfois expliquer notre démarche journalistique (…). On ouvre le débat sans trancher ». Le médiateur prône donc un dialogue entre journalistes et téléspectateurs sans nécessairement se livrer à une recherche du fautif. Les difficultés des uns à faire leur métier doivent être entendues, et le trouble des autres devant certaines informations doit être respecté.
Le médiateur de la rédaction est un journaliste aguerri, plutôt en fin de carrière. Ainsi, Didier Epelbaum a été nommé en 1998, à 52 ans, après avoir passé l’essentiel de sa carrière à France 2. Ayant acquis au sein de la rédaction la réputation d’un journaliste enclin aux réflexions déontologiques, il a eu plusieurs prises de position éthiques. Jean-Claude Allanic avait 57 ans au moment de sa nomination en 2000. Il est lui aussi issu de France Télévisions même s’il a fait ses débuts au service de politique étrangère du journal L’Humanité. Après avoir présenté quotidiennement une émission sur France 2 (C’est la vie), il a été successivement rédacteur en chef adjoint du 13 heures et de Télématin. Lui aussi est attaché à la déontologie du journalisme et à l’éducation aux médias et s’est investi sur ces questions au sein de la Société des journalistes de France 2 et dans le Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information, organisme qui travaille sur l’éducation aux médias dans les collèges et lycées.
Après avoir rendu le rapport sur la création de la fonction de médiateur en 1997, Didier Epelbaum a choisi de ne pas reprendre le vocable d’ombudsman pour désigner sa nouvelle fonction. « Chez les Américains c’est assez varié c’est-à-dire que eux ils sont… il y a des noms très différents. En Australie, c’est un bureau des plaintes, le nom le plus courant c’est ombudsmen comme au Canada et dans beaucoup de journaux (…), on trouve aussi des avocats du public ». Le médiateur français est un intermédiaire entre le public et la rédaction : « Je n’ai pas aimé le mot d’avocat, j’ai donc défini cela comme l’interprète du public auprès de la Rédaction et l’interprète de la Rédaction auprès du public. Et cette définition a été retenue ». Si Didier Epelbaum ne se reconnaît pas dans l’ombudsman, sans doute a-t-il été inspiré par le médiateur de la République et sa mission de « rapprocher les pouvoirs publics de ses administrés » (Delaunay, 1999).
Le contexte particulier de création et la conception originale du service de la médiation à France 2 en font un programme différent de ses équivalents nord-américains mais aussi scandinaves. Cette particularité influe sur son fonctionnement, avec une démarche qui tient plus de la mission tribunicienne que de la recherche d’une éventuelle faute.
Vers une fonction tribunicienne
L’Hebdo du médiateur, programmé à 13 h 20 juste après le journal télévisé de la mi-journée, occupe son plateau : le sérieux et la solennité marquent l’émission. Les deux médiateurs successifs nous ont expliqué que par manque de moyens, aucun plateau n’avait été attribué à l’émission mais la constance dans l’utilisation de ce plateau n’est pas anodine. Il inspire confiance tout en évoquant la transparence et le sérieux du journal télévisé. Le déroulement de l’émission est immuable depuis 1998. À la fin du journal télévisé, le présentateur laisse la parole au médiateur avec toujours la même formule : « Et maintenant place à L’Hebdo du médiateur« . Chaque numéro commence par une présentation de la teneur et de la tonalité des courriers reçus durant la semaine écoulée. Le rôle du médiateur de la rédaction étant de rendre compte à l’antenne des commentaires et critiques des téléspectateurs, ceux-ci s’expriment par courrier postal ou électronique. L’émission se déroule ensuite en cinq temps :
– le médiateur commence l’émission en situant le problème soulevé par les téléspectateurs ;
– une fois les critiques émises, les reportages incriminés sont retransmis partiellement, mais sans montage ;
– les commentaires des téléspectateurs reçus par le service de la médiation sont reproduits à l’antenne et lus par une voix off ;
– ensuite, le quatrième temps, normalement le plus long, est celui de l’enquête au sein de la rédaction et du débat en plateau ou en duplex entre téléspectateurs et responsables des images incriminées ;
– enfin, le médiateur conclut l’émission.
Le dispositif ainsi décrit semble effectivement favoriser un dialogue, même si deux niveaux de sélection viennent remettre en cause l’objectivité et la représentativité de ces échanges : c’est le médiateur qui choisit le thème qu’il va développer à l’antenne et qui sélectionne les courriers retranscrits durant l’émission. Enfin, le médiateur évalue les capacités communicationnelles des téléspectateurs qu’il souhaite recevoir en plateau. Ces derniers sont en effet contactés au téléphone dans la semaine précédant l’émission, le médiateur vérifiant leur habileté à s’exprimer, leur capacité à argumenter. Cette habile combinaison de commentaires de téléspectateurs et de précisions du journaliste durant l’émission permet de donner un surplus d’information : dans un dispositif informationnel, le retour sur le discours permet d’offrir un éclairage supplémentaire.
Nous pourrions au terme de cette analyse du dispositif de la médiation de France 2, établir le schéma récapitulatif suivant :
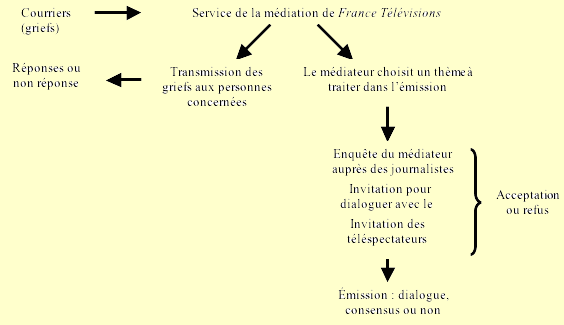
Schéma 1. Processus de médiation à France Télévisions
Ainsi, le fonctionnement des émissions autoréflexives est basé sur la relation télévision/téléspectateur. De façon schématique, ces programmes fonctionnent sur un échange à deux échelles : l’un virtuel ou symbolique entre l’institution télévisuelle et le public qu’elle s’imagine comme cible, et l’autre, incarné en plateau par le présentateur-journaliste, les téléspectateurs et les journalistes.
Si le dispositif est conçu pour créer et encourager ce dialogue ou cette volonté de dialogue, qu’en est-il de la teneur des échanges ? Dans sa volonté d’afficher un effort de transparence et d’explication, France 2 prône le dialogue avec ses téléspectateurs, mais dans un domaine aussi sensible que l’information et des revendications touchant aux pratiques professionnelles, nous pouvons questionner la véracité de ce dialogue. La franchise des propos échangés tient au fait que les acteurs sociaux défendent des convictions personnelles liées à une expérience primaire : celle d’être téléspectateur. Cependant, pour discuter, il faut qu’il y ait un motif de discussion, un point de désaccord. C’est ainsi que l’émission se rassemble autour d’une contestation formulée par les téléspectateurs, par courrier, et des objections faites par les professionnels de l’information à cette conviction de leur public. Au centre, un médiateur qui met en relation les deux parties en choisissant de traiter tel ou tel thème se dégageant des courriers, et qui cherche – ou non – un consensus. Ce modèle de conversation est un des éléments favorisant la discussion dans L’Hebdo du médiateur, au moins en intention. Cela ne signifie pas pour autant une absence de débat et un consensus mou permanent. L’obligation de convaincre, à laquelle pousse la situation télévisuelle d’exposition publique, a pour conséquence d’obliger les journalistes à argumenter et les téléspectateurs à convaincre du bien-fondé de leur intervention.
Ainsi, l’offre d’interactivité comble les téléspectateurs, satisfaits de pouvoir participer de chez eux. En retour, et c’est l’effet le plus important de ces actions, inciter à écrire, c’est suggérer au public de regarder ces discussions d’une certaine façon. Le dispositif encourage donc le débat. La chaîne a volontairement créé un espace de médiation, et les téléspectateurs démontrent chaque semaine leur envie de participer.
Cependant, les prises spontanées de parole sont extrêmement rares de la part des téléspectateurs, et se produisent quelquefois pour les journalistes. Les uns et les autres sont, le plus souvent, invités par le médiateur à prendre la parole. Les interventions de ce dernier pour lancer la discussion, ou introduire les différents participants donnent un rythme soutenu à l’émission. Ce sont des interventions courtes, mais qui lancent les échanges : « Alors ce qui vous a fait réagir, vous… », « Alors, à votre avis messieurs… ? », « Et vous madame … ? ». D’ailleurs, les téléspectateurs sont considérés comme des invités et Didier Epelbaum donne cet argument comme seule justification à la présence d’un téléspectateur sur le plateau de l’émission du 14 novembre 1998 : « Vous, je vous ai invité parce que vous êtes téléspectateur. Vous … ». Désigné ainsi, il se comporte comme tel et attend qu’on lui donne la parole pour intervenir.
L’animateur pose des questions afin de vérifier ce qu’il sait déjà : « Alors, vous ce qui vous a choqué, … c’est bien ça ? », « Il y a selon vous, vous nous l’avez écrit, … », « Alors, vous aussi, vous avez trouvé que… n’est-ce pas ? ». Le dispositif fait donc appel au témoignage du téléspectateur, on lui demande de raconter son expérience de téléspectateur face aux images, de reformuler ce qu’il a déjà exprimé par écrit. Les questions s’adressant aux journalistes tiennent, quant à elles, de la demande d’explications sur l’emploi de telle ou telle méthode. Ainsi, le médiateur demande : « FB, d’abord une précision… Comment avez-vous… » ? Ou encore « Alors MPF, vous étiez la rédactrice en chef, pourquoi avoir… ? ». L’échange ne progresse que par les questions de l’animateur, et chaque prise de parole est suivie d’une intervention du médiateur qui donne, reprend et distribue la parole. En conclusion, s’il y a dialogue, débat, l’exercice reste encadré et la parole non spontanée.
Le changement de médiateur en 2000 n’a pas été sans incidences sur le fond et la forme de l’émission. Le médiateur devant tout à la fois gérer le temps, gérer le sommaire et parfois donner son avis ou même trancher, il est normal que son temps de parole soit conséquent. Cependant, dans une émission qui affiche ouvertement « donner la parole » aux téléspectateurs, il est curieux de constater que les téléspectateurs ont moins la parole que le médiateur. Ainsi, lors de la première émission, Didier Epelbaum a accordé 3 minutes 58 aux deux téléspectateurs pour s’exprimer, soit 1 minute 29 par invité, contre 3 minutes et 2 secondes pour son propre temps de parole. Notons toutefois que les téléspectateurs avaient quand même bénéficié d’un peu plus de 30 % du temps total l’émission. Cependant, dès la deuxième émission, ce pourcentage retombait à 22 %, et même à 9 % un an plus tard, en 1999. De son côté, Jean-Claude Allanic, qui déclarait vouloir « un dialogue » entre journalistes et téléspectateurs, accorde plus de temps (environ 22 % du temps total, contre 20 % de 1998 à 2000) aux téléspectateurs que son prédécesseur. Ainsi, son propre temps de parole tend à se rapprocher de celui des téléspectateurs, qui eux bénéficient d’un espace d’expression comparable à celui des journalistes (24,5 %). Nous pourrions conclure que la parole est plus partagée dans L’Hebdo du médiateur de Jean-Claude Allanic que dans celui du premier médiateur. Cependant, ce réajustement des temps de parole se fait essentiellement au profit des journalistes et dans une bien moindre mesure au profit des téléspectateurs. Ce nouveau partage est à mettre en relation avec le choix du médiateur. En effet, Didier Epelbaum est considéré par ses pairs comme un intellectuel tout autant qu’un journaliste car il a écrit plusieurs livres d’histoire et a soutenu en 1998 un doctorat à l’École des hautes études en sciences sociales. Il a pris l’habitude d’enquêter sur les thèmes de l’émission et d’expliquer aux uns et aux autres les différents points de vue en présence. Jean-Claude Allanic est un journaliste, bien implanté dans la rédaction et dont le choix a été guidé par deux facteurs : sa proximité avec les journalistes, et ne pas avoir de liens avec le monde universitaire (Goulet, 2004). Quoi qu’il en soit, équilibrant les temps de parole, l’impression de dialogue est renforcée.
Le temps de parole dans cette émission laisse donc paraître une discussion installée malgré la grande présence de l’animateur et même si elle sert régulièrement d’outil de légitimation aux journalistes. Chacun semble avoir un rôle défini : le médiateur questionne, avertit, ordonne ; et les journalistes, ainsi que les téléspectateurs, argumentent, racontent, décrivent.
Conclusion
L’Hebdo du médiateur est un espace de débat, entre les téléspectateurs et les journalistes de la chaîne. Cet espace de débat permet-il d’améliorer pour autant les pratiques ? Les deux premiersmédiateurs s’accordent pour constater un effet limité de la médiation sur la rédaction et rejoignent ainsi la littérature nord-américaine qui reconnaît aux ombudsmen une faible influence sur les pratiques. Certes, la critique publique a permis de modifier quelques pratiques : les images violentes sont précédées d’un avertissement oral du présentateur, les informations non recoupées sont données au conditionnel, les sondages sont accompagnés d’une indication sur la marge d’erreur possible, etc. Mais les interrogations de fond ne sont pas touchées par l’effort de la médiation. Didier Epelbaum confie : « A quoi ça sert ? Je ne sais pas. Théoriquement ça devrait permettre d’améliorer la qualité du travail de la rédaction ». Vis-à-vis des téléspectateurs, le principal effet est sans doute de leur permettre d’être entendus et de s’exprimer. D’ailleurs, Didier Epelbaum, après avoir analysé les formes de médiation, a délibérément choisi, tout en admettant s’en inspirer, de se démarquer du modèle nord-américain. Il développe ainsi une fonction moins juridique, moins normative que son modèle d’inspiration.
La conception française de la médiation renvoi à l’idée d’une responsabilité collective, d’une réflexion collective. Or, c’est un individu, journaliste, reporter d’images, présentateur, qui est mis en cause et à qui le médiateur demande des comptes. Sans doute, faut-il y voir un effet du dispositif. Le petit format de l’émission (15 à 20 minutes), le plateau, le choix du direct, la volonté d’instaurer un dialogue et l’utilisation des courriers des téléspectateurs évoquant des exemples très précis, contribuent très certainement à individualiser les propos. Toutefois, au-delà des effets du dispositif, certaines tensions entre syndicats de journalistes, présentateurs, médiateur et direction laissent à penser que le fondement collectif de la responsabilité a du mal à passer l’épreuve des rivalités internes. Les relations notamment entre le directeur de l’information et le médiateur pèsent sur le déroulement de l’émission, comme ce fut le cas entre Jean-Claude Allanic et Olivier Mazerolles.
Quoiqu’il en soit, le modèle français revêt une fonction tribunicienne, assurant l’interface entre les journalistes et les téléspectateurs. L’analyse du fonctionnement du modèle canadien devrait nous permettre de « constater » plus avant les points de convergences et de divergences.
Le cas de Radio-Canada
Le premier ombudsman canadien a été celui du Toronto Star au début des années 70, un quotidien qui avait implanté le Star Bureau of Accuracy à la fin des années 1950. Le quotidien anglophone montréalais The Gazette a créé un poste similaire en 1981 (Langlois et Sauvageau 1989) mais il a été aboli à la fin des années 1990 dans le contexte de l’achat de ce quotidien par Conrad Black. Par ailleurs, dans un ouvrage récent consacré aux ombudsmen d’Amérique du Nord, Nemeth (2003) rapporte que le Edmonton Journal a eu un ombudsman de 1978 à 1993, et que le titulaire de cette fonction, John Brown, serait à l’origine de la création de l’Organization of Newspaper Ombudsmen qui allait devenir plus tard l’Organization of News Ombudsmen (ONO) en y intégrant des représentants de médias électroniques et même de nouveaux médias. Au Canada, on retrouve maintenant cinq ombudsmen de presse membres de l’ONO.
Au Québec, on ne retrouve aucun ombudsman dans les médias privés. L’unique ombudsman actif est celui de la Société Radio-Canada (SRC), nommé par le président de la société. Les ombudsmen sont donc relativement rares dans un pays comptant 105 quotidiens (Vivian et Maurin 2000), et des milliers d’hebdomadaires, de magazines et de journaux communautaires ou ethniques.
Nomination et autonomie
En août 1992, une résolution a été adoptée pour réviser les procédures du Bureau de la politique et des pratiques journalistiques « afin de faire de l’ombudsman un instrument vraiment efficace de responsabilité journalistique, et que l’on étudie les moyens de le rendre plus indépendant par rapport à la Société » (Groupe d’étude sur le bureau de l’ombudsman, [Gebo] 1993, 1). Dans le préambule du rapport, on note l’importance de l’expérience journalistique et du courage dont l’ombudsman doit faire preuve pour jouer un rôle utile face au public. À cet effet, le Gebo estimait que le modèle exemplaire de l’ombudsman en Amérique du Nord était celui du Washington Post, notamment parce qu’on y confiait cette fonction à quelqu’un qui n’était pas employé du journal, que le titulaire avait un contrat de deux ans renouvelable une seule fois et qu’il était convenu qu’il ne pourrait plus jamais travailler pour ce média par la suite, ni pour aucun de ses services.
Le Groupe d’étude considérait alors ce degré d’indépendance essentiel « si un organisme entend se doter d’une telle instance comme instrument de responsabilité publique. Les gens n’accorderaient aucune crédibilité à une personne qu’ils percevraient comme un employé agissant uniquement comme un tampon entre les journalistes et le public » (Gebo 1993, 3). Il ajoutait que les médias et organismes étudiés privilégiaient un modèle proche de celui du Washington Post et recommandait « que la SRC accorde clairement à son ombudsman le mandat de devenir le représentant des auditeurs et des téléspectateurs et que toute fonction qui pourrait venir en confit avec cet objectif soit supprimée de ce mandat » (Gebo 1993, 3).
En matière de recrutement, le Groupe d’étude insistait sur l’indépendance du candidat retenu et laissait entendre que celui-ci devait provenir de l’extérieur de la SRC car il faudrait que le titulaire ait un mandat « d’une durée déterminée et ferait préférence l’objet d’un contrat, bien qu’il ne faille pas exclure la possibilité de recruter un candidat au sein de l’effectif même » (Gebo 1993, 4). Il ajoutait toutefois que si le candidat provenait du personnel de la SRC, cela devrait être son dernier emploi car il lui serait difficile de réintégrer la hiérarchie par la suite.
La direction de la SRC n’a pas suivi ce modèle puisqu’elle confie systématiquement son poste d’ombudsman à un journaliste maison en fin de carrière, et celui-ci peut toujours profiter de contrats de la SRC par la suite, comme cela a été le cas pour un de ses ombudsmen du service français qu’elle a embauché pour travailler après sa mise à la retraite. Un de ces mandats l’a même conduit à prendre la défense de la SRC sur la place publique quand elle a été confrontée à la controverse pour son Histoire populaire du Canada, une série d’émissions que d’aucuns associaient à une œuvre de propagande fédéraliste, biaisée et favorable à l’unité nationale (pour plusieurs raisons historiques et politiques, un très grand nombre de Québécois voudraient se séparer du Canada et plusieurs doutent de la neutralité de la SRC dans ce débat en raison de ses liens avec le gouvernement fédéral).
L’étendue de la fonction
Le Bureau de l’ombudsman créé, ses titulaires successifs ont le mandat d’enquêter sur les plaintes et de faire connaître leurs décisions aux responsables des services visés tout comme aux plaignants. Ils communiquent aussi leurs constatations au président-directeur général ainsi qu’aux cadres de l’information.
Les titulaires du Bureau doivent être indépendants et neutres face à la SRC, ce qui comporte des difficultés. La neutralité et l’indépendance que l’ombudsman revendique, ainsi que l’implantation d’une procédure pour l’analyse des plaintes, laissent croire que ce processus est équitable pour les plaignants. C’est du reste ce que l’ombudsman affirme quand il écrit que le « mécanisme de dépôt et d’analyse des plaintes en provenance des auditeurs et des téléspectateurs qui a été mis en place à Radio-Canada, en 1993, est le plus complet, le plus équitable, le plus ‘démocratique’ qui soit au Canada, en Amérique du Nord et probablement dans le monde. Aucune autre entreprise de presse ne demande à ses cadres de répondre à toutes les plaintes qu’elle reçoit et aucune entreprise de presse n’a un ombudsman jouissant d’une indépendance aussi grande que celle de l’ombudsman de Radio-Canada » (1999-2000, 78). Cependant, une recherche consacrée aux décisions de l’ombudsman révèle que celui-ci a une tendance marquée à privilégier la Société Radio-Canada dans le sort qu’il réserve aux plaintes sur lesquelles il se penche annuellement (Bernier 2005), ce qui mine sa crédibilité quant à son autonomie et son indépendance.
Le mandat de l’ombudsman de la SRC ne contient aucun pouvoir de sanction, celui-ci est laissé aux gestionnaires responsables des journalistes mis en cause. En entrevue, l’ombudsman en poste nous a déclaré ne pas rechercher un tel pouvoir, compte tenu qu’il ne peut évaluer l’ensemble du travail des journalistes car il doit se concentrer sur un seul des très nombreux reportages qu’ils font chaque année. Par ailleurs, il croit que « c’est peut-être plus facile de faire accepter une décision s’il n’y a pas de pouvoir de sanction. Ça évite sûrement les conflits ».
Son fonctionnement
Pour mieux comprendre le fonctionnement du Bureau de l’ombudsman français de Radio-Canada (le réseau anglais, Canadian Broadcasting Corporation ou CBC, a lui aussi son ombudsman), nous avons procédé à une analyse de contenu quantitative et qualitative des décisions contenues dans les rapports annuels de 1992-1993 à 2000-2001 (2). Nous avons aussi analysé les sections de ces rapports où l’ombudsman dresse un bilan annuel de ses activités et de ses préoccupations. Une entrevue a également été réalisée avec l’ombudsman en poste à l’automne 2001 afin de mieux comprendre sa vision du rôle qu’il assume. L’entrevue a été suivie d’une correspondance pour préciser certains points. Le corpus analysé regroupait de façon exhaustive les 144 décisions rendues par les ombudsmen qui se sont succédés depuis 1992. Les rapports annuels de 1993 à 2000 contenaient aussi des milliers de lettres ou de références à des appels téléphoniques du public qui critiquait la SRC.
Le mandat de l’ombudsman radio-canadien consiste à enquêter sur les plaintes des citoyens lorsque ces derniers jugent qu’ils n’ont pas obtenu des explications et des justifications satisfaisantes de la part des responsables des émissions d’information et d’affaires publiques mis en causes, lesquels répondent en première instance. Cette première étape est cruciale car le modèle d’imputabilité mis en place à la SRC « repose sur le principe de la responsabilité journalistique, de sorte que les personnages qui produisent les émissions doivent en répondre directement à leur direction mais aussi devant le public » (SRC 1994-1995, 82). En somme, l’ombudsman n’intervient que si le plaignant fait une demande de révision. Il est en seconde et dernière ligne, bien que certains cas d’exception aient été identifiés.
Les décisions de l’ombudsman portent donc sur les griefs exprimés en première instance, griefs qui ont suscité des réponses que le plaignant ne trouve pas satisfaisantes. Ce dernier doit alors écrire à l’ombudsman et lui demander de réviser le dossier. Pour procéder à sa révision, l’ombudsman s’en remet uniquement aux griefs formulés dans la première lettre et non à des griefs et commentaires faisant suite à la réponse obtenue en première instance. L’ombudsman explique s’en tenir à la première lettre « en toute équité envers les responsables de l’émission et aussi pour respecter rigoureusement la procédure de traitement des plaintes » (SRC 1995-1996, 43). Il a donc refusé plusieurs fois de tenir compte d’éléments supplémentaires contenus dans des demandes de révision. Mais il lui arrive parfois d’hésiter et il n’exclut pas catégoriquement de prendre en considération certaines observations contenues dans la seconde lettre « au même titre que les rencontres ou les conversations que peut avoir l’ombudsman dans sa démarche d’enquête » (SRC 1999-2000, 106). Toutefois, cette règle de la première lettre souffre des exceptions, comme ce fut le cas pour une décision où l’ombudsman analysera les griefs de trois plaintes de l’Ordre des dentistes du Québec, acheminées par l’intermédiaire de leurs procureurs. Il justifie cette dérogation à la procédure en invoquant la complexité du sujet (les amalgames dentaires) et afin d’être « équitable envers chacune des parties » (SRC 1996-1997, 2).
Il se peut que la règle de la première lettre soit à la limite de l’équité pour les personnes peu familières avec le mandat de l’ombudsman et avec ses procédures, car elles sont en quelque sorte prisonnières des imperfections ou imprécisions de leur première correspondance, alors que la demande de révision porte en réalité sur le reportage et non sur la réplique du responsable de l’émission. L’existence de cette règle procédurale révèle l’importance capitale de rédiger explicitement et de manière fort documentée la plainte dès la première étape du processus d’imputabilité, ce qui peut avantager les plaignants mieux organisés et familiers avec les médias comme le suggère du reste notre analyse quantitative.
Pour prendre une décision, l’ombudsman nous a déclaré s’appuyer principalement sur un volumineux document normatif intitulé Normes et pratiques journalistiques(NPJ) de la SRC. Ce document fait état des pratiques et valeurs professionnelles reconnues : équité, rigueur, exactitude, intégrité, impartialité, respect de la vie privée, procédés clandestins, etc. Le schéma suivant illustre le modèle d’imputabilité de l’information mis en place à la SRC. Il tient compte de la procédure officielle et explicite de la SRC, mais aussi des cas d’exception que nous avons observés. En ce sens, ce schéma est davantage conforme avec le modèle d’imputabilité réel qu’avec la description qui en est généralement faite.
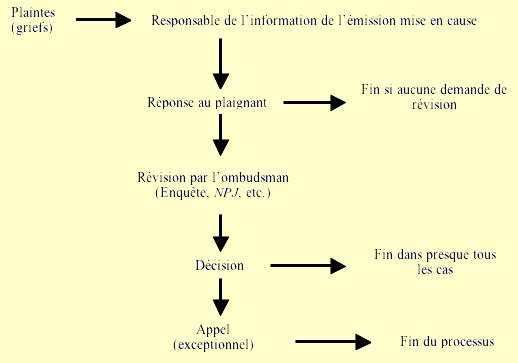
Schéma 2. Le modèle d’imputabilité de l’information de la SRC
Le processus d’imputabilité de l’information de la SRC repose largement sur l’enquête réalisée par l’ombudsman pour les plaintes qui se rendent en seconde instance, au stade de la révision. Pour répondre aux plaignants, il lui arrive d’entreprendre des recherches approfondies dans des ouvrages consacrés aux sujets qui ont fait l’objet des reportages controversés. Il en a été ainsi, par exemple, en ce qui concerne l’histoire des chevaliers de l’Ordre de Malte, qui était un élément important d’une plainte, ou encore de la définition de l’ésotérisme quand il a dû se pencher sur une plainte concernant le rapprochement fait entre une firme de consultants en relations de travail associée au Mouvement du Graal et à l’Ordre du temple solaire. Ces recherches peuvent parfois être exhaustives et, lorsque cela est le cas, l’ombudsman cite alors les ouvrages consultés pour appuyer sa position. Dans une longue décision concernant les origines du drapeau québécois, l’ombudsman s’est livré à un véritable travail de fond, se référant à de nombreux documents historiques pour répondre aux 29 commentaires et griefs d’un plaignant qui considérait qu’un reportage télévisé manquait grossièrement de respect envers le drapeau et, partant, le peuple québécois. On n’y trouve pas moins de 87 renvois à 51 articles, livres et documents divers qui retracent les grands débats ayant entouré l’importance des croyances religieuses dans l’historique du fleurdelisé. Il en profite aussi pour noter que certains propos de René-Daniel Dubois, un auteur dramatique et metteur en scène, étaient inexacts et même « injurieux » envers le drapeau québécois, sans toutefois injurier toute la collectivité québécoise. Il reconnaît que ces propos étaient injustifiés et contraires aux Normes et pratiques journalistiques (SRC 1999-2000, 47).
Mais les recherches de l’ombudsman ne sont pas toujours exhaustives. Pour analyser une plainte de discrimination à l’endroit des musulmans, à la suite de reportages concernant un Égyptien qui a enlevé ses cinq enfants nés au Québec pour les emmener dans son pays d’origine, l’ombudsman dit avoir consulté un imam et un juriste spécialiste du droit égyptien, mais n’a pas tenté de communiquer avec le père, « convaincu [qu’il était] qu’une telle démarche ne donnerait rien » (SRC 1995-1996, 78). Cela ne l’empêche pas d’attribuer au père des motivations et intentions de nature religieuse et juridique qui expliqueraient son comportement. Toutefois, dans une autre décision impliquant une certaine connaissance de l’islamisme et du Pakistan, l’ombudsman a fait appel à environ 30 personnes, la plupart étant des universitaires (SRC 1996-1997).
Il lui arrive parfois de faire référence à l’opinion d’experts qu’il n’identifie pas, par exemple lorsqu’il répond à un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada que « les juristes que j’ai consultés se prononcent avec beaucoup moins de certitude » (SRC 1993-1994, 29) sur un sujet précis soulevé dans la plainte. Ailleurs, il signale avoir « consulté plusieurs personnes du monde du journalisme et du monde universitaire » en plus d’avoir « pris connaissance d’un certain nombre d’ouvrages traitant du droit du public à l’information et de la vie privée des individus » (SRC 1993-1994, 68-69) pour répondre à la plainte d’un ex-ministre du gouvernement canadien. Dans une autre décision, il est allé un peu plus loin dans sa démarche en soumettant le reportage controversé « à un panel d’anciens journalistes de l’extérieur de Radio-Canada mais familiers avec les règles de déontologie du journalisme » (SRC 1994-1995, 65), sans expliquer pourquoi il a cru bon de procéder de cette façon.
L’ombudsman prend parfois la peine de rétablir le contexte dans lequel l’émission visée a été produite. Ainsi, pour une plainte concernant La Bande des Six (une émission culturelle à la fois critique, satirique et cynique), il écrit que si un animateur a lancé « C’est une folle ! » à l’endroit d’une avocate ayant produit un livre sur les abus de la liberté d’expression des critiques, cela ne serait pas étranger à des propos similaires tenus la même semaine par l’ex-président du Collège des médecins du Québec à l’endroit d’une avocate se plaignant d’avoir été agressée sexuellement par son médecin. De plus, l’ombudsman mentionne que les animateurs de cette émission en étaient à la dernière émission régulière car La Bande des Six était définitivement retirée des ondes. Il profite de cette plainte pour faire savoir qu’il « existe un certain danger à analyser le contenu d’une émission dans une atmosphère complètement aseptisée, trois mois après sa diffusion. La communication, quelle qu’elle soit, n’est jamais indifférente au climat de l’époque… » (SRC 1993-1994, 71). En tenant compte du « climat de l’époque » de production d’une émission d’information, l’ombudsman a recours à un cadre interprétatif qu’on ne retrouve pas dans les Normes et pratiques journalistiques en vigueur. Cela témoigne de la discrétion qu’il s’accorde dans l’interprétation des NPJ comme nous avons pu le constater à plusieurs reprises lors de l’analyse du corpus.
La diffusion des décisions
La diffusion de ses décisions passe essentiellement par le rapport annuel de l’ombudsman. On peut noter que de 1992-1993 à 1999-2000, la tendance a favorisé une certaine transparence, notamment par la publication en nombre limité de rapports exhaustifs en deux ou trois volumes, dans lesquels on trouvait les lettres des plaignants, les réponses du responsable de l’émission mise en cause, les demandes de révision souvent accompagnées d’une réplique aux propos du responsable et, finalement, les décisions de l’ombudsman. On y retrouvait aussi un registre de toutes les plaintes et commentaires du public concernant aussi bien les émissions d’information que la programmation de variétés.
Le rapport annuel était exhaustif et avait officiellement un caractère public mais il était d’accès difficile, sa diffusion étant restreinte. En somme, son degré de diffusion n’était pas proportionnel à son degré d’exhaustivité. L’arrivée d’un nouvel ombudsman, le cinquième depuis 1992 (le troisième ombudsman étant décédé subitement, il a été temporairement remplacé par l’ombudsman du réseau anglais avant la nomination de celui que nous considérons être le cinquième ombudsman, pour les besoins de l’analyse) a modifié radicalement cette situation puisque le rapport annuel 2000-2001 est accessible sur l’Internet, mais il a perdu grandement de son exhaustivité car on n’y trouve plus qu’un résumé de la plainte et un résumé de la décision. De plus, le rapport présente toujours l’identité du plaignant et l’émission mise en cause, mais l’identité des journalistes visés est gardée confidentielle alors qu’elle était présente dans les rapports annuels précédents. À ce titre, on peut dire qu’il est moins transparent que les précédents.
En entrevue, l’ombudsman a expliqué qu’il considère qu’une plainte n’implique pas seulement le journaliste visé, mais une équipe et un processus de production, le journaliste n’étant que l’acteur le plus visible : « Alors moi, je me suis dit que si on se plaignait d’un élément d’information, au fond on se plaignait d’une émission donnée. Et puis, c’est comme ça que je suis arrivé un peu à la conclusion que c’était peut-être mieux de ne pas mettre les noms des journalistes ». Cette décision n’est pas irrévocable, a-t-il laissé entendre. Notons qu’en adoptant cette perspective, l’ombudsman semble vouloir privilégier le concept de la responsabilité collective ou institutionnelle, une conception d’inspiration européenne qui accorde un plus grand poids aux structures et à l’organisation du travail, plutôt que le concept de la responsabilité individuelle plus conforme avec la tradition nord-américaine dont les textes normatifs font reposer la responsabilité sur les agents moraux plutôt que sur les institutions.
À compter du rapport annuel 2000-2001, l’ombudsman explique se limiter dorénavant aux faits saillants des activités de son Bureau dans le but « d’élargir le distribution et de faciliter la lecture du rapport », notamment en l’affichant intégralement sur le site Internet de Radio-Canada (SRC 2000-2001, 2). L’ombudsman résume donc les plaintes parvenues au stade de la révision ainsi que sa réponse, tout comme il présente une synthèse des rapports de différents comités consultatifs mis sur pied dans le cadre des élections fédérales de 2000. Ses résumés sont présentés sans faire référence au principe journalistique mis en cause. Quand deux plaintes similaires se suivent, il lui arrive même de résumer une plainte et une décision en quelques mots : « Plainte semblable, réponse semblable » (SRC 2000-2001, 14).
Conclusion
Nemeth estime que l’ombudsman peut être un agent efficace d’imputabilité interne ou externe quand cette fonction est créée avec pour finalité d’être à l’écoute des plaintes et commentaires du public. On peut dire que dans une certaine mesure, le Bureau de l’ombudsman de la SRC remplit ce rôle. Certes, ce mécanisme n’est pas parfait, aucun mécanisme d’imputabilité ne l’est, mais il est possible de l’améliorer afin de s’assurer que l’information de cette radio et de cette télévision publiques continue à être parmi les meilleures qui soient au Québec, malgré ses défauts, ses faiblesses et ses erreurs.
La fonction d’ombudsman est un mécanisme d’imputabilité médiatique qui respecte le concept d’autorégulation dans des sociétés démocratiques reconnaissant à la fois la liberté de la presse et les responsabilités sociales des médias. Les ombudsmen de presse sont relativement rares pour des questions de coûts et de principes (des propriétaires estiment que leurs gestionnaires peuvent s’occuper à la fois de la production de l’information et de l’évaluation critique de sa qualité), mais leur nombre demeure en lente progression.
Bien entendu, les entreprises de presse ne peuvent être contraintes d’embaucher un ombudsman, mais celles qui le font volontairement démontrent leur volonté d’être imputables au sein d’une société qui valorise le fait d’avoir une presse libre et peu réglementée (Nemeth 2000b, 64), dans la mesure où cette presse assume également ses responsabilités sociales et sait être à la hauteur de ses prétentions éthiques et déontologiques.
Au terme de leur étude, Langlois et Sauvageau observaient la popularité des ombudsmen de journaux canadiens et se demandaient s’il n’était pas temps que des médias francophones se dotent d’un tel mécanisme (1989, 209). Pour l’instant, le seul média francophone québécois qui a répondu positivement à cet appel a été la SRC. À l’automne 2001, la Commission de la culture de l’assemblée nationale du Québec a déposé un rapport à la suite d’audiences publiques relatives à l’état de la concentration de la presse. Une des recommandations du rapport visait justement la création de postes d’ombudsmen indépendants et crédibles au sein des conglomérats médiatiques, afin d’assurer la qualité de l’information. Quelques années plus tard, rien de tel ne s’annonce dans le paysage médiatique québécois.
Conclusion générale
Globalement, un certain nombre de points communs peuvent être relevés entre les deux modèles, notamment des éléments très concrets du processus. Ainsi, les statuts du médiateur sont quasi similaires : il est nommé, il est autonome et indépendant au sein de son entreprise. Il n’a pas de compte à rendre aux journalistes de la rédaction. Pour ce poste sensible, les deux établissements, France Télévisions comme la Société Radio-Canada ont choisi de nommer des journalistes aguerris, issus de leurs propres rangs et plutôt en fin de carrière. Les philosophies associées à ces modèles de médiation impliquent une forme de responsabilité collective. Dans le cas de la SRC, toutefois, cela émerge de l’analyse des décisions de l’ombudsman alors que les Normes et pratiques journalistiques font plutôt référence à une philosophie individualiste de la responsabilité professionnelle.
Cependant, le contexte de création du service de la médiation, bien connu des deux côtés de l’Atlantique, laisse apparaître des divergences certaines. En France, il s’insère dans une situation de crise des médias, crise de crédibilité de l’information, et nécessité de reconquérir un public. En outre, les pouvoirs publics ont clairement exprimé la volonté de voir s’établir un tel service. Ainsi porté par les instances nationales, le service de la médiation entre dans la concurrence entre secteur privé et public, ce dernier trouvant là un élément de démarcation. Au Canada, les quelques ombudsmen en fonction assument des rôles différents et plus ou moins formels, selon qu’ils soient dans le secteur public ou privé, dans la presse écrite ou électronique. Cela reflète du reste la diversité observée aux États-Unis. De plus, l’ombudsman est un mécanisme d’autorégulation qui s’inscrit dans un contexte canadien plus large qui comprend aussi des Conseils de presse plus ou moins dynamiques, selon les provinces, ainsi qu’une tradition de métajournalisme, c’est-à-dire du journalisme qui se consacre à la couverture plus ou moins critique des médias d’information (Bernier 1995).
Le principe de responsabilité collective ne semble pas aussi prégnant dans la pratique française que dans les médias canadiens.Ceci étant dit, l’ombudsman de Radio-Canada est sans doute le modèle le plus formel sur le plan procédural en ce qui concerne le cheminement des plaintes, mais l’analyse révèle un certain impressionnisme, un certain flou dans le raisonnement, sinon de l’arbitraire dans les décisions qui en émanent. Néanmoins, le poste d’ombudsman a été créé pour faire face à une certaine crise de confiance du public qui est incité à s’en méfier pour des motifs de partialité fédéraliste au Québec, tandis que dans certaines provinces anglophones de l’ouest du Canada ce sont des critiques de la droite politique qui dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une partialité « gauchiste » de la part des journalistes radio-canadiens. On doit aussi ajouter que la crise de confiance frappe l’ensemble des institutions sociales, les médias n’étant pas épargnés.
La différence entre les modèles présentés ici est bien illustrée par le choix initial de Didier Epelbaum pour le nom de son nouveau statut : médiateur et non ombudsman. Il opte pour un modèle moins juridique que la SRC. Si l’inspiration est bien celle du modèle de l’ombudsman, l’application est à chercher plutôt du côté du médiateur de la République et dans la culture de la confrontation républicaine d’idées. Le médiateur de France 2 est une sorte de facilitateur de dialogue. Le modèle radio-canadien se veut plus procédural et plus normatif. En principe, il privilégie l’analyse de cas en fonction de normes précises, accessibles à tous, dans un cadre où la compétence médiatique du plaignant n’a aucune importance (il ne doit pas se justifier à la télévision par exemple).
Autre point de divergence : il n’existe pas de recherche de la faute dans L’Hebdo du médiateur ou très peu, car le but réel de l’émission est de créer un dialogue, une interaction entre téléspectateur et journaliste. Les journalistes viennent expliquer la façon dont ils ont procédé mais il n’y a pas véritablement d’enquête et aucun pouvoir de sanction possible. L’ombudsman de la SRC, au contraire, fait enquête et doit prendre une décision où il accepte ou rejette les plaintes, en tout ou en partie. Il doit donc décider s’il y a eu transgression déontologique.
Surtout, tout le dispositif français repose sur la bonne foi des différents acteurs : c’est les téléspectateurs qui écrivent, ce sont les journalistes concernés qui répondent ou qui ne répondent pas, c’est le médiateur qui choisit un thème, etc. Il n’y a pas, comme dans le modèle canadien, de possibilité d’enquête systématique si le public n’est pas satisfait de la réponse qui lui a été faite, il n’y a pas non plus de possibilité d’appel. Un grief qui n’aura fait l’objet d’aucune réponse et qui n’aura pas été traité par l’émission, sera classé sans suite. Le téléspectateur n’a aucun moyen de forcer les journalistes à s’expliquer.
Ce qui est véritablement intriguant, c’est cette volonté qu’a le public d’intervenir. Les téléspectateurs français ont véritablement investi le dispositif pour accéder à une forme de parole publique. Les discussions dépassent très largement le simple champ des médias pour se transformer en débat sur des problèmes dits de société. Celui-ci permet tout à la fois de renouveler les acteurs du débat public avec l’intégration d’une parole profane, mais de nouveaux thèmes émergent également dans l’espace public grâce à cet espace de débat. D’une certaine façon, cette fonction tribunicienne sert également de système d’alarme, laissant se discuter des thèmes en éclosion, des problèmes potentiellement publics en construction conjointement par les médias et par les téléspectateurs.
L’émission française ne cherche pas qui a tort ou raison. De toute façon jusqu’en 2000, France 2 ne disposait pas de textes sur lesquels se référer. Le médiateur ne pouvait donc pas trancher car il ne n’avait pas de règles pour se positionner. Depuis, il existe une Charte de l’antenne rédigée par le premier médiateur Didier Epelbaum, et il n’est pas rare d’entendre le médiateur citer cette charte dans certaines affaires. Cependant, cette charte ne comporte aucune sanction. À Radio-Canada, le texte normatif existe de longue date, mais l’analyse de contenu révèle que dans près de 53 % des décisions, ces normes sont passées sous silence, si bien que les plaignants ne savent pas toujours pourquoi leurs griefs ont été acceptés ou rejetés. Il semble que le fait de ne pas référer explicitement aux normes en vigueur accorde plus de latitude à l’ombudsman pour se montrer « compréhensif » face aux égarements des journalistes d’une institution qui est aussi la sienne de longue date.
Que le modèle soit juridique ou corresponde à une fonction tribunicienne, le dernier point commun concerne leurs effets limités sur les pratiques. C’est pourquoi sans doute n’est-ce pas là qu’il faut chercher le véritable rôle de la médiation. Il est possible, cependant, que le modèle radio-canadien puisse avoir des impacts majeurs, notamment quand les tribunaux civils s’inspirent en partie des décisions de l’ombudsman pour se prononcer sur la faute professionnelle et pour accorder des dommages aux plaignants, comme cela a été confirmé en juillet 2004 par la Cour suprême du Canada. Par ailleurs, la conception pluraliste des sociétés démocratiques encourage la diversité des mécanismes d’imputabilité journalistique (conseils de presse, lettres ouvertes, métajournalisme, recherche scientifique, etc.), ce qui enlève à la fonction d’ombudsman ou de médiateur la lourde mission, impossible, de corriger toutes les failles des pratiques journalistiques.
Notes
(1) Le parlement de la Suède a décidé, en 1809, de créer un poste de protecteur du citoyen qui serait en quelque sorte le gardien de l’équité des décisions administratives du gouvernement. Ce concept a été transposé pour conduire à la création de postes de représentants des lecteurs de la presse écrite ou représentants de l’auditoire de la presse électronique. Du reste, plusieurs membres de l’Organisation of News Ombudsmen (ONO) sont décrits comme des représentants des lecteurs, du public ou des assistants du rédacteur. Voir Bernier (2005).
(2) Dans le cas du rapport annuel 2000-2001, l’analyse quantitative a été minimale car sa présentation était radicalement différente des rapports des années précédentes et occultait plusieurs variables prises en compte jusque-là. Toutefois, un résumé des plaintes et des décisions permet une certaine analyse qualitative.
Références bibliographiques
Bernier Marc-François, L’ombudsman de Radio-Canada : protecteur du public ou des journalistes ?, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2005.
Bernier Marc-François, Les Planqués. Le journalisme victime des journalistes, Montréal, VLB Éditeur, 1995.
Delaunay Bénédicte, Le Médiateur de la République, PUF, 1999.
France 2, Vous et nous, site Internet <http://www.france2.fr/semiStatic/61-141-NIL-NIL.html> (page consultée en janvier 2001).
Goulet Vincent, « Le médiateur de la rédaction de France 2 : l’institutionnalisation d’un public idéal », in Questions de communication n° 5, 2004.
Goulet Vincent, Une rédaction face à ses téléspectateurs. Le médiateur de la rédaction de France 2, Mémoire de DEA de sociologie, EHESS, 2001. Document non publié, disponible à l’INAthèque.
Groupe d’étude sur le bureau de l’ombudsman (Gebo), Rapport final, Société Radio-Canada, 1993.
Langlois Simon et Sauvageau Florian, « L’image de l’ombudsman de presse dans deux quotidiens canadiens », Communication, vol. 10, n° 2-3, éd. Nota Bene, université de Laval (Québec), automne 1989, p. 189-210.
Nemeth, Neil, News Ombudsman in North America: assessing an experiment in social responsibility, Wesport, Praeger, 2003.
Nemeth Neil, « A News Ombudsman as an Agent of Accountability » in Pritchard, David, Holding the Media Accountable: Citizens, Ethics, and the Law, Indianapolis, Indiana University Press, 2000b, p. 55-67.
Romeyer Hélène, L’autoréflexivité télévisuelle, entre communication médiatique et espace public de débat. Les cas Arrêt sur images et L’Hebdo du Médiateur, thèse sous la direction de Bernard Miège, université Stendhal, Grenoble 3, 2004.
Société Radio-Canada, Normes et pratiques journalistiques, Montréal, 1993.
Société Radio-Canada, Rapport annuel de l’ombudsman du service français, Montréal, de 1992-1993 à 2000-2001.
Société Radio-Canada, Le Bureau de l’ombudsman, Montréal, 2001 <http://www.cbc.radio-canada.ca/htmfr/5_1.htm>
Veron Eliséo, Construire l’événement. Les médias et l’accident de Three Mile Island, Paris, Éditions de Minuit, 1981.
Vivian John, Maurin Peter J., The Media of Mass Communication, Scarborough, Allyn and Bacon Canada, 2nd edition, 2000.
Auteurs
Marc-François Bernier
.: Professeur agrégé au département de communication de l’Université d’Ottawa (Canada), Marc-François Bernier a été journaliste professionnel au Québec pendant près de vingt ans. Détenteur d’un doctorat en science politique, il se spécialise dans l’éthique, la déontologie et la sociologie du journalisme. Il est notamment l’auteur de Éthique et déontologie du journalisme (Presses de l’Université Laval, 2ème édition, 2004, préface de Dominique Wolton) et de L’ombudsman de Radio-Canada : protecteur du public ou des journalistes ? (Presses de l’Université Laval, 2005). Il est membre du Groupe de recherche sur les Pratiques novatrices en communication publique de l’Université Laval (Québec) et témoin expert devant les tribunaux civils dans des causes de diffamation impliquant des journalistes.
Hélène Romeyer
.: Docteur en Sciences de l’information et de la communication, Hélène Romeyer est l’auteur d’une thèse de troisième cycle ayant pour titre Autoréflexivité télévisuelle : entre communication médiatique et espace public de débat. Les cas Arrêt sur images et L’Hebdo du médiateur. Membre associée du Gresec, ses travaux se concentrent sur la question de l’espace public médiatique et actuellement sur les discours portant sur la santé.
